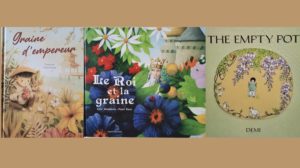Le tissage traditionnel de la soie, une affaire de famille chez les De La Calle
Dès que la porte de la boutique du 11 rue Mourguet, dans le quartier pavé Saint Georges du Vieux- Lyon s’ouvre, sous le tintement des clochettes, nous mettons le pied dans l’univers de la famille de La Calle... Au sens propre comme au sens figuré puisqu’au sol, notre regard se porte immédiatement sur une magnifique mosaïque, représentant autour d’une royale fleur de lys, les cinq outils les plus utilisés par les canuts, les tisseurs de soie lyonnais, à savoir : la navette, le valet, la servante, la paire de force et la pincette.
C’est un bond de deux cents ans en arrière que nous vous proposons aujourd’hui : bienvenue dans les ateliers des Soieries Saint Georges !

Les Soieries Saint Georges, une affaire familiale
Pour la petite histoire, cette mosaïque a été réalisée par les tantes de Romain et Virgile de La Calle, les deux sœurs « très complices et complémentaires » comme elles se définissent, de leur père Ludovic de La Calle : Valérie et Dominique Villéna, mosaïstes de talent, installées désormais à Aix-en-Provence. Romain et Virgile de La Calle, nous accueillent et travaillent dans cet atelier familial, créé à l’origine par leur père Ludovic.
C’est en 2023, ensemble, qu’ils reprennent cet atelier après le départ en retraite de leur père. Dans ce lieu chargé d’histoire, ils tissent sur des métiers Jacquard du XIXe siècle des pièces de soie exceptionnelles, essentiellement destinées à la rénovation de fauteuils par exemple ou à la tapisserie, mais ils consacrent aussi beaucoup de temps à la médiation culturelle destinée à tous publics.

Parcours de Ludovic de La Calle, père
Les frères nous racontent ainsi l’histoire de leur père. Il a passé une grande partie de sa jeunesse dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon et a ainsi pu rencontrer les anciens tisseurs de la Cooptiss. Voici donc le point de départ du fil d’Ariane de sa vie...
Monsieur Ludovic de La Calle va suivre alors une première formation à l’école de tissage dans les années 1970 durant laquelle il sera apprenti chez les anciens. Après son diplôme, il retournera chez les anciens de la Croix Rousse, puisqu’ essentiellement à cette époque, existait encore là-bas, une centaine d’ateliers.
Pour rappel, chers amis lecteurs, le premier métier à tisser artisanal, s’appelle le « métier à la tire ». Il existe depuis le Xe siècle en Chine et il est arrivé en Italie lors de la Renaissance, puis, en France dès le XVIIe siècle. Ce métier « à tisser à la tire » permettait la maîtrise des tissus à motifs. Son essor fut accru sous le règne de Louis XIV, avec la mode de Versailles s’imposant dans toute l’Europe, rayonnant depuis Lyon. Le « métier à la tire » fut ensuite remplacé par le « métier à tisser, dit Jacquard », au début du XIXe siècle. La Croix Rousse était donc le haut lieu de tissage de la soie au XIXe siècle, à Lyon puisque ce quartier avait été spécialement créé pour y accueillir les nouveaux « métiers à tisser dits Jacquard ».
C’était donc plus facile pour se spécialiser sur métier à tisser, dit traditionnel, en plus du métier à tisser-mécanisé pour M. de La Calle. Ainsi, a-t-il forgé son savoir-faire, dans plusieurs ateliers de la Croix-Rousse, pour ensuite entrer à la Maison des Canuts, anciennement la Cooptiss, où il y gravit les échelons. C’est dans ce lieu qu’il a appris toutes les techniques de tissage de la soie, toujours avec les anciens. Puis, à son tour, il a dirigé la Maison des Canuts durant des années, pour continuer à transmettre son prestigieux savoir-faire. La transmission du savoir-faire est ainsi incluse dans un beau cercle vertueux, chez les canuts lyonnais.
Romain et Virgile ont grandi à la Croix-Rousse. Enfants, ils gardent de nombreux souvenirs de ces ateliers, de ces métiers à tisser la soie, de l’ambiance qui régnait. Leur père les laissait gambader parmi les métiers à tisser. Ils observaient ainsi naturellement comment les machines fonctionnaient. Les deux frères ont chacun fait des études dans des domaines différents, Virgile de La Calle en gestion, par exemple. Les deux frères insistent tous deux pour mentionner que jamais leur père ne les a obligés à suivre sa voie. Il les a toujours laissés libres de leurs choix. Il les a ainsi laissés quitter le nid familial pour mieux être libres d’y revenir.
C’est en 2000, lorsque Ludovic de La Calle laisse la Maison des Canuts qu’il crée cet atelier de tissage rue Mourguet, rue au nom du créateur du célèbre Guignol Lyonnais.
Rue Mourguet, il amène du matériel qu’il a sauvé de la destruction ou de l’oubli. Venir dans le Vieux-Lyon, cela faisait sens pour lui, cela lui tenait à cœur. C’est ici même que tout a commencé... L’arrivée des premiers italiens à la Renaissance qui apprenaient à tisser aux lyonnais. Ces Italiens tisseurs qui sous l’égide de François Ier vinrent s’installer à Lyon, moyennant des avantages fiscaux.

Romain de La Calle, le fils aîné de la famille, âgé aujourd’hui de 39 ans, travaille dans cet atelier depuis plus de dix ans maintenant. Virgile de La Calle, son frère, quant à lui, a rejoint l’atelier familial en 2019, il y a donc un peu plus de cinq ans. Une complémentarité tangible existe entre les deux frères. Petit à petit, ils ont appris auprès de leur père « les ficelles du métier », sans mauvais jeu de mots. Leur père leur a appris le tissage. Tout ce qu’il sait. Il leur a transmis comment réparer les métiers à tisser, comment installer les fils parce que les frères ne font pas que tisser.
Il y a énormément de temps de maintenance où ils entretiennent les machines également. Le but est de les utiliser correctement afin qu’elles durent encore longtemps. En 2023, Ludovic de La Calle a pris officiellement sa retraite mais il n’est jamais bien loin pour compléter le processus d’apprentissages de ses fils. Romain et Virgile de La Calle apprennent encore, enrichissent encore leur précieux savoir-faire, auprès de leur père.
Ludovic de La Calle déclare lors d’une interview accordée à France 3, intitulée Lyon, capitale historique de la soie, je cite : « Pour moi, c’était très important de transmettre ce que les anciens m’avaient appris, parce que sinon j’aurais raté quelque chose dans ma vie ».
L’artisanat est donc bien une grande histoire de famille chez les de La Calle. La famille est précieuse. Les membres de la famille de la Calle ont tissé, au fil du temps, des liens d’affinités entre chacun d’entre eux, ce qui a permis à l’entreprise de s’épanouir, au sein d’une belle coopération, d’une belle collaboration familiale. À eux tous, ils représentent la plus pure illustration du principe de « Piété filiale », considérée comme une vertu au cœur de l’éthique confucéenne : maintenir la fraternité entre frères et sœurs, respecter les anciens, respecter les parents. Pour Confucius, maintenir la piété filiale, c’était aussi acquérir une valeur fondamentale de sagesse, à savoir, le Ren (prononcez « jeunn »), soit la tolérance, l’endurance, la patience.
Le cœur du métier des Soieries Saint Georges
Romain de La Calle nous explique : « Aujourd’hui, nous avons tout d’abord une mission pédagogique, une mission éducative ».
Un devoir de mémoire donc...
« Nous présentons notre atelier. Nous recevons du public toute l’année.
Notre but au départ était de ne pas être enfermés dans un atelier de tissage mais de recevoir des groupes ou des particuliers qui souhaitent découvrir un atelier fonctionnant comme au XIXe siècle. Les emmener 200 ans en arrière, c’était très important à nos yeux. Il faut quand même savoir qu’il s’agit du dernier atelier du Vieux-Lyon à être ouvert au public. Nous les éclairons sur l’histoire des Canuts, l’histoire du tissage qui est importante à Lyon. Nous leur montrons les pièces que nous réalisons sur un métier Jacquard. »
« Nous expliquons également l’histoire du ver à soie, depuis son cocon jusqu’à la pièce finie qui a été exécutée ici dans notre atelier. C’est gratuit pour les particuliers. Les visiteurs peuvent nous questionner sur notre univers. Les Soieries Saint Georges proposent en partenariat avec l’Office du tourisme de Lyon une visite qui s’appelle " Visite en famille ", avec des enfants de tous les âges et ce, surtout durant les vacances scolaires. »

Saviez-vous chers lecteurs que la sériciculture, soit l’élevage des vers à soie, serait née, selon la légende, sous la dynastie des Han ?
En effet, la jeune épouse nommée Leizu du célèbre Empereur Jaune encore appelé Huangdi, selon les écrits de Confucius, aurait découvert un cocon de soie dans sa tasse de thé brûlant vers 2 640 av. J.-C. La princesse dégustait alors son thé sous un mûrier dans le jardin du Palais Impérial. Désireuse d’ôter le cocon tombé dans sa tasse chaude, elle aurait ainsi déroulé tout le fil du cocon. Ses servantes s’amassant autour d’elles, émerveillées de la longueur extraordinaire de l’unique fil de soie de ce cocon. Leizu fut aussi époustouflée par les qualités antinomiques de cet unique fil, à la fois très résistant et d’une extrême douceur.
C’est alors qu’elle aurait ordonné de récolter des milliers de cocons afin de fabriquer une tenue qu’elle offrirait à l’Empereur Jaune, son époux. Celui-ci lui recommanda donc d’observer, patiemment, en premier lieu, la vie du Bombyx du mûrier : le fameux papillon dont est issu le ver à soie. C’est ainsi, qu’ensuite, Leizu commença à enseigner à son entourage l’art de l’élevage du ver à soie et inventa le premier métier à tisser la soie. Dès lors, la jeune femme incarna dans la mythologie chinoise, « la Déesse de la soie. »

Ainsi, pourrez-vous admirer, chers lecteurs, sur le blog de Shen Yun Performing Arts, une statue de la princesse Leizu, tenant une grande pièce de soie entre les mains, avec des feuilles de mûrier sculptées, dans un parc du Yuan’an, dans la province du Hubei.
C’est ainsi que le peuple chinois garda le secret de la sériciculture durant de très longues années… jusqu’à ce qu’il arrive en France.
La Princesse Leizu et l’Empereur Jaune auraient sans nul doute été d’accord avec Léonard de Vinci, qui faisait l’éloge de la nature en ces termes : « Va prendre tes leçons dans la nature. C’est là qu’est notre futur ».

Romain de La Calle nous explique qu’à l’époque, au XVIIe siècle, en France, en terres cévenoles donc, des magnaneries ont été développées jusqu’à ce que la Révolution Industrielle, vers 1850, arrive et propose plus tard, des fibres synthétiques artificielles (viscose), constituées d’un fil de cellulose, moins coûteuses que la soie naturelle, et qu’en plus, apparaissent malheureusement des maladies, comme la pébrine, qui ravageront nombre d’élevages de vers à soie, avant que Pasteur ne trouve un remède. Ces deux grands facteurs combinés, par voie de conséquences, provoqueront petit à petit l’abandon de l’exploitation des magnaneries en France.
D’ailleurs, chers amis lecteurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, vous pourrez lire un livre en famille qui s’intitule La fabuleuse histoire de la soie en Cévennes, rédigé par Nelly Duret et Frédéric Cartier-Lange, aux Éditions Icide Jeunesse.
« Les magnaneries étaient donc des fermes à cocons essentiellement situées dans les régions de l’Ardèche et des Cévennes. C’est pourquoi, encore aujourd’hui, de nombreux mûriers poussent dans la nature là-bas. Ceux-ci avaient été plantés par l’homme pour nourrir les vers à soie. Le ver à soie dévore de grandes quantités de feuilles de mûrier. Il va alors grossir, grossir jusqu’à se transformer en chenille toute blanche et lorsque celle-ci aura atteint une longueur d’environ 10 cm, elle arrêtera de se nourrir et alors comme le font les araignées, elle secrètera un fil de soie qui sortira directement de sa bouche. Elle s’entourera ensuite de ce fil de soie, durant quatre jours et quatre nuits, pour créer son cocon. »
Romain secoue un cocon de l’atelier pour que nous entendions un petit bruit à l’intérieur...

« Si nous laissons faire la nature, elle se métamorphosera en papillon appelé Bombyx du mûrier qui sortira de son cocon et comme c’est un papillon éphémère, il mourra très rapidement. Dans les magnaneries pour récupérer le fil de soie, les cocons vont être ébouillantés. Une colle naturelle (la séricine) se défera de celui-ci et le fil de soie pourra se dérouler en une seule fois. Vous obtenez en moyenne un kilomètre de soie sur un cocon.
Pour obtenir un fil plus ou moins épais, il faudra mélanger entre 5 et 35 fils de cocons ensemble. Pour fabriquer une mousseline de soie par exemple, les mouliniers utiliseront 5 à 10 fils de cocons réunis pour un seul fil. La soie partait des magnaneries de l’Ardèche, vers la Loire, à une heure de Lyon. Là-bas, ils avaient une très bonne qualité d’eau. Ils y faisaient également toute la partie teinture et la coloration. Ainsi, cela arrivait chez les canuts en matière première, déjà teintée et prête à être utilisée. »

Romain nous montre des bobines de soie de toutes les couleurs, ainsi qu’un nuancier sur lequel nous trouvons plus de 1 400 échantillons de couleurs différentes. (Livre de la Nouvelle collection du printemps 1902)
Saviez-vous, chers lecteurs, que selon certains scientifiques, l’œil humain pourrait distinguer une très large palette de nuances de couleurs ? La moyenne pour un humain serait de dix millions de nuances alors que certains humains seraient capables d’en distinguer plus de 100 millions selon leur environnement !

La couleur naturelle de la soie est plutôt blanche, beige. Des perruques étaient d’ailleurs fabriquées avec ces fils de soie pour Versailles. Les perruques pouvaient atteindre une hauteur d’un mètre sur la tête de certaines dames de la Cour !
Mais, revenons à notre ver à soie, celui-ci n’est plus élevé, ni en Europe, ni en France ! C’est principalement la Chine et le Brésil qui l’élèvent et l’exportent dans le monde entier.
« Que ce soit Les Soieries Saint Georges, Hermès ou n’importe quel soyeux lyonnais, il semble très difficile désormais d’acheter de la matière première française concernant la soie, sous forme de fil brut ou sous forme de fil teinté », comme le souligne Romain.
Par contre, pour lui : « Tout le reste : les dessins, l’impression, le tissage, les finitions, tout cela peut être réalisé dans la région lyonnaise. La matière première a disparu en Europe avec l’arrivée de l’industrialisation et des métiers mécanisés du XIXe siècle, de plus de nouvelles matières sont apparues comme le polyester, le pétrole, le coton, la laine, des matières finalement beaucoup moins onéreuses que la soie. La Chine est arrivée en même temps. Tout cela fait que l’élevage du ver à soie a été peu à peu abandonné, surtout d’un point de vue technique ».
Nous constatons que Romain et Virgile de La Calle, non seulement sont de jeunes tisseurs de talents passionnés d’histoire, mais également de très bons orateurs pédagogues, puisqu’avec eux nous ne voyons pas le « temps filer » paradoxalement. Sans doute ont-ils tiré cette qualité du côté maternel puisque, nous confient-ils, leur mère était enseignante, passionnée également d’histoire avec son époux. Donc, raconter l’histoire de la soie est un réel plaisir pour eux.
Collaboration Jade Lee
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.