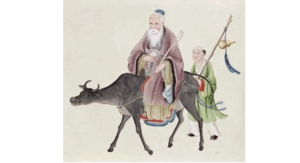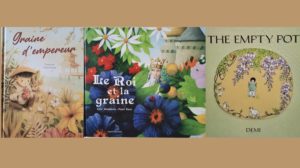À une époque où la vitesse est devenue une vertu et le silence un vide à combler, il peut sembler paradoxal de prôner la pleine conscience et l’art du silence numérique ? Pourtant, l’influenceur le plus lent au monde au fond de la campagne chinoise à emprunter cette voie
Dans une petite ferme de la campagne chinoise, un homme a rassemblé près d’un million d’abonnés en ne faisant presque rien : si ce n’est de rester immobile tandis que les graines germent, que les nuages passent, que les mois se muent en années. Ses vidéos lentes et méditatives semblent nous interroger : si le repos lui-même peut être une forme de résistance, à quoi résistons-nous exactement ? Au monde, ou à notre propre impatience ?

À travers son regard, la croissance devient révélation, et le silence une forme de vérité. En le regardant, nous sommes confrontés à une question que nos écrans nous permettent rarement de poser : et si l’avenir n’appartient pas aux plus rapides d’entre nous, mais à ceux qui ont appris à évoluer avec le temps plutôt que contre lui ?
Dans sa petite ferme nichée au cœur de la campagne chinoise, l’homme reste assis immobile près d’un lopin de terre. Ses vêtements sont délavés, son regard fixe. Autour de lui, le temps s’écoule différemment : une graine germe, le ciel se transforme, les ombres s’allongent lentement sur une crête. En quelques secondes, l’écran condense ce qui a mis des mois, voire des années, à se déployer. La vidéo s’achève, laissant des millions de spectateurs muets et étrangement calmes.
Il ne danse pas, ne vend rien, ne propose pas de performance inédite. Et pourtant, près d’un million de personnes le suivent sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Son fil d’actualité est rempli de méditations en accéléré sur la croissance : des haricots qui se déploient, de la mousse qui s’épaissit, des choux qui fleurissent, de la brume qui descend une vallée. Toujours le même décor. Toujours le même homme, les mains dans la terre, la posture sereine. Dans un monde en ligne bâti sur l’accélération, sa présence est comme une pause.
Une révolution discrète dans le fil d’actualité
Parcourir Douyin donne l’impression d’avoir le mal de mer. On n’y voit des passages sans transition d’un plan au plan suivant, toutes les secondes, des vidéos virales, des visages qui crient dans le vide. Attirer l’attention est une monnaie d’échange, et l’algorithme récompense l’excès. Pourtant, au milieu de cette déferlante poussée à l’outrance, un homme qui filme discrètement des légumes depuis deux ans est devenu une star.

On pourrait être tenté de parler d’ironie. Mais son succès relève moins du paradoxe et plus de la prophétie. À une époque où la culture numérique semble s’accélérer à l’extrême, les gens sont attirés par ce qui se déroule lentement, voire imperceptiblement. Sa chaîne ne propose ni chutes spectaculaires, ni « contenu ». Elle offre une continuité.
Sur le site web américain Reddit dans les discussions sur le slow living, et sur Weibo, sous ses publications, ses abonnés décrivent ses vidéos comme une « thérapie pour le temps ». Un spectateur a écrit : « Il ne publie pas souvent, mais quand il le fait, j’ai l’impression d’avoir attendu avec lui ». Ce commentaire résume parfaitement son attrait : il ne s’agit pas de divertissement, mais d’accompagnement. Le regarder, c’est comme emprunter la patience de quelqu’un d’autre.
L’influenceur le plus lent au monde et l’acceptation de l’impermanence
Les psychologues commencent à identifier ce besoin comme une forme de restauration de l’attention – notre esprit se remet d’une surstimulation grâce à des expériences calmes et rythmées. Ses vidéos agissent presque comme un encens numérique : elles ne vous saisissent pas, elles vous apaisent. Filmer ce qui ne peut être précipité

Dans une brève interview publiée par un média local, le créateur explique que chacun de ses projets en accéléré lui prend entre deux mois et deux ans. Le processus est ardu : installer la caméra au même endroit chaque jour, en s’adaptant au vent, à la pluie, aux insectes et aux variations de lumière. « Il faut accepter la perte », explique l’influenceur le plus lent au monde. « Parfois, la plante meurt, et il faut recommencer. »
Cette résignation – cette acceptation de l’impermanence – est en elle-même l’art. Chaque image nous rappelle que la beauté dépend de la lente coopération du temps. Sa tenue répétitive, inchangée au fil des saisons, est devenue, presque par hasard, un synonyme de constance. Qu’il le veuille ou non, cela renforce le fil conducteur spirituel de son travail : une dévotion à la constance dans un monde qui y est allergique.
Le résultat est cinématographique, même s’il ne se considère jamais comme un cinéaste. Chaque vidéo est une ode miniature aux forces invisibles qui façonnent la vie : la gravité, la lumière du soleil, la décomposition. L’objectif de la caméra révèle ce que l’œil humain ne perçoit pas : le mouvement du silence, la pulsation de l’immobilité.
Filmer la croissance, c’est reconnaître sa propre mortalité. Ses séquences – de la graine à la tige, du bourgeon à la floraison, puis à la décomposition – portent un rythme émotionnel qui transcende les mots. Les vidéos sont souvent accompagnées de paysages sonores ambiants : le vent, l’eau, un carillon. L’effet est monastique, comme être assis auprès de quelqu’un qui a appris non seulement à attendre, mais aussi à écouter.
Du Tao au numérique : la philosophie de l’immobilité

Consciemment ou non, sa pratique fait écho à la philosophie chinoise ancestrale du taoïsme. Le Tao, souvent traduit par « la Voie », met l’accent sur l’harmonie avec les rythmes naturels, la non-ingérence et la futilité du progrès forcé. Le principe taoïste du wu wei – littéralement « non-action », mais mieux compris comme « alignement sans effort » – imprègne chaque pixel de ses vidéos. Lao Tseu écrivait dans le Tao Te King: « La nature ne se presse pas, et pourtant tout s’accomplit. » En ce sens, le contenu du fermier est plus qu’esthétique : il est une incarnation philosophique. Son refus de se presser est un acte moral dans une époque d’impatience.
Les créateurs ruraux de la Chine moderne, parmi lesquels des figures emblématiques comme Li Ziqi, ont ravivé l’intérêt pour la vie agricole et l’artisanat traditionnel. Pourtant, l’influenceur le plus lent au monde se distingue. Si les vidéos de Li Ziqi évoquent un folklore raffiné, les siennes sont une pure méditation : la terre n’est pas une scène, mais un maître. Il n’explique ni n’interprète son travail : il le répète. Cette répétition – planter, arroser, attendre, filmer – est un sermon en soi.
Ce geste attentif et répétitif constitue une forme de rébellion silencieuse contre une culture numérique qui assimile nouveauté et valeur. Dans la cosmologie taoïste, le calme n’est pas absence, mais équilibre. Et c’est précisément ce que perçoit son public. En observant la croissance de ses plantes, nous ne fuyons pas le temps ; nous nous souvenons comment l’habiter.
L’art de la pleine conscience rurale

La Chine rurale a toujours revêtu une forte charge symbolique : simplicité, endurance, lien profond à la terre. Mais pour ce créateur de contenu, il ne s’agit pas de nostalgie, mais de pleine conscience. Son jardin devient un véritable coussin de méditation. Son corps, sans artifice ni filtre, transforme les gestes les plus ordinaires – balayer, arroser, s’asseoir – en poésie. La pleine conscience occidentale se présente souvent sous forme d’applications, de cours ou de tapis de yoga. Lui, c’est différent. C’est implicite, sans marque : c’est ancré dans le réel. C’est viscéral. Il ne l’appelle pas « pleine conscience » car il n’en a pas besoin : il la vit.
Il y a quelque chose de presque littéraire dans la répétition visuelle. Chaque séquence est un haïku, ou poème bref, en mouvement. Une image réduite à l’essentiel, qui invite le spectateur à percevoir ce qui demeure non-dit. Dans une vidéo devenue virale, le brouillard enveloppe un champ tandis que la lumière du matin filtre à travers. Le fermier est assis de profil, immobile, comme s’il attendait que la montagne respire. Les internautes plaisantent en disant qu’il doit être « l’influenceur le plus patient du monde », mais derrière l’humour se cache une profonde reconnaissance. Il incarne ce que nous avons perdu : la capacité de vivre au rythme d’autre chose que celui de l’horloge.
Pourquoi l’avenir pourrait être plus lent

Plus la vie numérique s’accélère, plus ce qui ne peut être précipité prend de la valeur. Aux États-Unis, les recherches de « contenu lent » et de « minimalisme numérique » ont explosé. Sur les réseaux sociaux chinois, des hashtags comme #SlowLifeChallenge (慢生活挑战) et #RuralRebirth sont populaires auprès des jeunes citadins en quête d’équilibre mental. Ce mouvement ne vise pas à rejeter la technologie, mais à se réapproprier son attention. La popularité discrète du fermier prouve que même les algorithmes ne peuvent pas totalement supprimer notre besoin de calme. Paradoxalement, ce sont les mêmes plateformes qui profitent du chaos qui amplifient aujourd’hui la tranquillité.
Dans son ouvrage La Société de la Fatigue, le philosophe Byung-Chul Han écrit que la fatigue moderne provient d’un « excès de positivité » : trop d’actions, trop de désirs, trop de réussite. À l’inverse, l’influenceur qui prône la lenteur incarne la capacité négative : le pouvoir de rester indéfini, de ne pas forcer les choses, d’exister. Son succès suggère que les gens ne sont pas seulement fatigués : ils souffrent d’un profond mal du pays, d’un manque spirituel. Ce mal du pays est universel. Sur tous les continents, un courant culturel alternatif se dessine : bains de forêt au Japon, slow TV en Norvège, retraites de pleine conscience dans la Silicon Valley. Tous ces mouvements témoignent d’une redécouverte de la lenteur comme forme de survie.
Les vidéos de ce fermier nous rappellent que l’attention, telle une graine, ne germe qu’avec le temps. Son jardin numérique est dépourvu de publicités, de slogans, d’artifices – juste de la lumière, de la terre et de la patience. L’influence la plus réelle réside peut-être moins dans ce qui devient viral que dans ce qui perdure.
Ce qui demeure : le temps est le véritable maître et non le contenu

Dans l’une de ses premières publications, un jeune arbre perce le gel, son vert tendre défiant le froid. Des mois plus tard, il fleurit, puis se fane. La caméra reste immobile. Aucun message, aucune conclusion – juste la vie qui suit son cours silencieux et infini. Dans ce silence, nous percevons quelque chose de rare : une paix non construite, une beauté non recherchée. Ses films lents nous rappellent que le temps, et non le contenu, est le véritable maître. C’est peut-être pourquoi son public y revient sans cesse. En le regardant, ils ne cherchent pas l’évasion, mais un retour : au rythme, à la patience, au sens.
Rédacteur Charlotte Clémence
Source : The Slowest Influencer on Earth: Rural Mindfulness and the Art of Digital Stillness
www.nspirement.com
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.