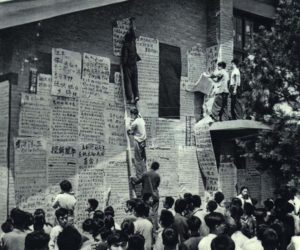Le surtourisme est d’autant moins une fatalité, que le secteur s’adapte sous l’influence des voyageurs. Une demande pour un autre tourisme, plus respectueux de l’environnement, moins intensif, émerge depuis quelques années. Cette « douce » pression amène le secteur à se métamorphoser. Trop lentement, estimeront certains. Profondément, rétorqueront les autres.
En raison des coûts environnementaux des déplacements des visiteurs et de pratiques peu respectueuses des lieux, des espaces sensibles, et des communautés locales, le tourisme est souvent pointé du doigt. Cette description est encore noircie par la médiatisation croissante des mouvements anti-touristiques d’habitants inquiets ou épuisés par la pression touristique de leurs lieux de vie. Penser que le tourisme n’a pas su évoluer serait pourtant réducteur. Bien au contraire, il y a une évolution croissante dans la prise en considération des enjeux de durabilité depuis la naissance du tourisme de masse.
Ce cadre intégrateur nommé « l’échelle de progression de la durabilité touristique » est l’occasion de rappeler que le tourisme n’est pas un phénomène déshumanisé. Le tourisme est le résultat d’une accumulation de pratiques individuelles de déplacement, d’attentes d’expériences et d’exploration, de désirs, de moments de détente et de rencontres, qui est portée par des voyageurs et des vacanciers, c’est-à-dire ce que nous sommes tous.
Le tourisme est fait par les touristes (nous !), et comme les préoccupations des touristes évoluent (nous évoluons dans nos vies et dans nos aspirations !), le tourisme ne cesse de se réinventer, et cela en étant profondément engagé sur une trajectoire de durabilité (Figure 1).
L’échelle de progression de la durabilité touristique
Surtourisme, tourismophobie et recettes touristiques
Depuis les années 1950, l’industrie mondiale du tourisme connaît une forte croissance qui n’a été que provisoirement impactée par les épisodes de confinements et de restrictions de la Covid-19. Ces dynamiques d’expansion touristique nationales et internationales ont mis en lumière le phénomène de surtourisme, défini comme une affluence de touristes dépassant la capacité d’accueil d’une destination. Considéré en termes de vécu subjectif plus que de chiffres objectifs, ce sentiment de débordement engendre des impacts négatifs pour les habitants, les visiteurs et les écosystèmes locaux.
Les impacts négatifs d’une fréquentation non maîtrisée peuvent également engendrer une aversion pour le tourisme, appelée tourismophobie, qui est marquée par la crainte, l’hostilité et le rejet social, souvent liés à des pratiques touristiques de masse non durables.
Parce que le tourisme est aussi une source de revenus économiques, de développements, d’échanges culturels et de pacification entre les peuples, il devenait urgent de repenser les pratiques touristiques pour limiter les effets délétères du développement du tourisme.
Un défi majeur et une priorité

Face aux enjeux environnementaux et aux menaces pesant sur les habitats naturels partagés par touristes et locaux, le tourisme durable apparaît comme un défi majeur et une priorité pour l’industrie contemporaine. Il repose notamment sur la consommation durable, définie comme « la consommation de biens et de services répondant aux besoins essentiels sans compromettre ceux des générations futures ».
Pour promouvoir l’adoption de comportements touristiques respectueux de l’environnement, il est important d’identifier combien les touristes sont motivés par les dimensions vertueuses de l’éthique et du durable. En effet, les préoccupations relatives à la santé de la planète et à l’assurance de délivrer un héritage de qualité pour les générations futures sont devenues essentielles. Les propositions touristiques qui proposent de s’engager et de se connecter à la nature sont celles désormais jugées à très forte valeur par les touristes car au-delà des bénéfices immédiats pour l’environnement, elles offrent des bénéfices individuels en termes de santé mentale et physique.
L’émergence du tourisme lent
Encore peu étudié par les chercheurs, le tourisme lent est une tendance touristique en émergence. Représentant une forme plus achevée que le tourisme durable, le tourisme lent permet de ralentir non seulement physiquement, mais aussi mentalement, et d’échapper au mode de vie pressé que les touristes adoptent avant de voyager.
Le flux temporel est une dimension importante de l’expérience touristique. La décélération chez les voyageurs fait référence à la recherche par les individus d’opportunités pour échapper au rythme trépidant de la vie et s’engager dans diverses formes de consommation lente que ce soit pour se déplacer, se nourrir et s’occuper. Des recherches internationales approfondies définissent l’expérience du tourisme lent comme « des vacances au cours desquelles les touristes prennent plus de temps et font preuve de plus de flexibilité pour, tout en cherchant l’harmonie avec la nature, les communautés locales, leurs habitants et leur culture, s’engager plus intensément et personnellement dans la découverte des offres touristiques ».
L’élément au cœur de l’expérience du tourisme lent est la notion du rythme de la consommation. Un tourisme plus ralenti est alors perçu comme vertueux et suscite des sentiments positifs sachant qu’il faut que les contraintes environnementales soient faibles pour qu’il y ait intention de voyage ou de revisite.
Pour évaluer si une offre touristique s’inscrit dans la tendance du tourisme lent, les auteurs proposent un cadre théorique construit sur 6 continuums :
- Flexibilité (de haute à basse),
- Engagement social sur place (de riche à superficiel),
- Consommation de la localité (de l’attachement au détachement),
- Expérience concrète de la destination (de riche à superficielle),
- Perceptions de la valeur (de haute à basse),
- Vivre le moment (de intensément à faiblement).
Outre l’apport théorique, ce cadre donne des consignes concrètes pour concevoir des offres touristiques du tourisme lent.
Le tourisme régénératif
En mettant l’accent sur la réparation, la restauration et la reconstruction, le tourisme régénératif marque un tournant stratégique pour le secteur du tourisme et constitue une réponse prometteuse pour transformer, reconsidérer et réduire les dommages environnementaux du tourisme conventionnel.
Le tourisme régénératif offre à l’industrie un solide potentiel de transformation qui constitue une nouvelle étape vers la réflexion et le développement durable. Le tourisme régénérateur consiste à « proposer aux visiteurs des activités qui permettront aux destinations de guérir, tout en contrebalançant les impacts sociaux, économiques et environnementaux du tourisme ».
Du point de vue des prestataires touristiques, il existe cinq dimensions clés pour décrypter le tourisme régénérateur :
- la durabilité,
- l’harmonie avec les communautés,
- la restauration des ressources,
- la compensation carbone
- les économies d’énergie.
Ces clés sont les leviers que les praticiens et les fournisseurs du tourisme doivent activer pour restaurer concrètement les destinations et façonner un avenir touristique durable.
Une source d’inspiration

Le tourisme régénérateur comprend deux dimensions essentielles du point de vue des consommateurs : la durabilité et la restauration. Le tourisme régénérateur est perçu comme une source d’inspiration et a un impact positif à la fois sur l’héritage personnel et sur la volonté des touristes de participer à nouveau. L’héritage personnel des touristes fait référence au sentiment de responsabilité qu’ils éprouvent à l’égard des générations futures et à leur désir de changer le monde en mieux et de laisser un impact durable sur ce monde qui aidera les générations futures et aura un effet positif durable sur la société.
En outre, les aspects moraux interviennent de la manière suivante : les touristes à la moralité élevée sont plus enclins à s’engager dans des activités de tourisme régénératif. Leur souci de « bien faire » pour les générations futures plutôt que pour eux-mêmes se traduit par un sens moral plus fort, qui les amène à s’attendre à un héritage personnel moins important et qui reflète leur nature altruiste.
Inversement, d’autres sont plus motivés pour « se montrer » et créer une image positive d’eux-mêmes sur le moment. Ces conclusions orientent sur la manière de promouvoir le tourisme régénérateur auprès de tous les touristes : insister pour les uns sur les avantages d’une cause altruiste et à long terme et, pour les autres, sur les avantages de la gratification instantanée et la communication de soi suite à cet engagement régénérateur qui est socialement valorisé. Quelle que soit la voie choisie, l’objectif final et sain de la transformation peut alors être atteint !
La prochaine étape : une vision circulaire et automotivante du tourisme
Signe d’une nouvelle phase d’évolution du tourisme, de futures recherches vont rapidement porter sur l’économie circulaire dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Il s’agit par exemple de la consommation d’aliments locaux aux hôtels et restaurants neutres en CO2. La gestion des déchets alimentaires dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie est aussi une voie de recherche prometteuse. Il faut aussi approfondir le rôle du tourisme dans la préservation et la régénération de la flore et de la faune locales en s’appuyant sur l’analyse internationale des situations reconnues de succès et de « best practices ».
Enfin, l’analyse et la validation des indicateurs de « visites nettes zéro » dans les destinations est une piste importante, tout comme les recherches sur la signification personnelle et le pouvoir de développement et de transformation personnels que représentent, pour un individu, les pratiques de ces tourismes vertueux.
Qu’il soit durable, lent ou régénérateur, quels sont les bénéfices ressentis par l’individu voyageur lorsqu’il adopte ces pratiques durables, et comment faire en sorte que ces expériences touristiques soient l’ancrage et le ciment à partir duquel le voyageur ne désire plus autre chose que ces expériences plus vertes et plus vertueuses ?
Rédacteur
Rédacteur Charlotte Clémence
Auteurs
Christine PETR : Professeur des Université en Marketing - Sciences de Gestion et du Management, Université Bretagne Sud (UBS). Aikaterini Manthiou : Professeure de marketing, Neoma Business School. Cet article est republié du site The Conversation, sous licence Creative Commons
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.