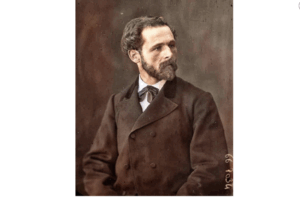Une équipe franco-italienne a pu analyser six échantillons d’eau de nuage prélevés au sommet du massif auvergnat du puy de Dôme à différentes saisons, entre 2023 et 2024. Les chercheurs y ont décelé 32 pesticides différents, dont plusieurs interdits en Europe depuis plus d’une décennie. Un tiers des échantillons présentaient également une concentration totale de pesticides supérieure aux taux réglementaires pour l’eau potable.
Leur travail pionnier a aussi permis d’estimer, pour la première fois, la quantité de pesticides qui se trouveraient dans l’ensemble des nuages bas et moyens de France hexagonale, soit de 6 à 139 tonnes. Retour sur cette publication inédite, avec sa première autrice.
The Conversation : quelle est la genèse de votre recherche ?
Angelica Bianco : Avec ma collègue chimiste Pascale Besse-Hoggan, experte de l’ICCF (UCA/CNRS) en (bio)dégradation des pesticides dans les sols, nous voulions, depuis quelques années, quantifier les pesticides dans les nuages, car les pesticides sont des contaminants d’intérêt dans toutes les matrices environnementales.
Une étude récente du chercheur Ludovic Mayer et de ses collègues avait déjà rapporté la présence de pesticides dans les aérosols atmosphériques prélevés sur 29 sites en Europe, dont plusieurs en troposphère libre, soit la première couche de l’atmosphère de la Terre qui débute d’un à deux kilomètres d’altitude et qui n’est que peu ou pas affectée par les émissions locales.
De plus, la présence de pesticides dans les précipitations est connue depuis longtemps, avec des travaux notables à la fin des années 1990. Nous avons donc profité de l’Observatoire du puy de Dôme, géré par l’Observatoire de physique du globe (OPGC) de Clermont-Ferrand et par le Laboratoire de météorologie physique (LaMP) de l’Université de Clermont-Ferrand (UCA) et du CNRS, pour quantifier les pesticides dans une matrice encore inexplorée jusqu’à présent : les nuages.
Techniquement, ce n’est pas la première mesure dans les nuages. En 1991, l’équipe du chercheur allemand Franz Trautner avait déjà mesuré l’atrazine, un herbicide aujourd’hui interdit qui bloque la photosynthèse de végétaux et qui était fréquemment utilisé dans les champs de maïs, dans plusieurs échantillons collectés dans un même nuage au-dessus de cultures de maïs dans les Vosges avec des concentrations allant de 24 à 260 nanogrammes par litre (ng/l), soit bien plus que la limite autorisée pour l’eau potable.
L’originalité de notre dernière étude repose sur la quantification des pesticides :
- dans plusieurs échantillons d’eau de nuage, collectés à deux saisons différentes ;
- avec des masses d’air d’origines différentes (différentes saisons, différentes températures et différentes origines géographiques) …
- avec une analyse de 446 pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, biocides) et quelques produits de dégradation ;
- avec des limites de détection très faibles en utilisant des méthodologies certifiées (Cofrac).
Nous savions déjà qu’un nombre important de pesticides étaient présents dans les cours d’eau. Il peut donc sembler logique d’en trouver également dans les nuages, cependant, de telles recherches n’ont pas tellement été menées auparavant. Comment expliquez-vous cela ?
A. B. : Les nuages représentent la matrice environnementale la plus difficile à attraper et à échantillonner : ce n’est pas de l’eau d’un lac ou d’une rivière que l’on peut prélever aisément avec un seau et en grande quantité. Ce ne sont pas non plus des poussières ou des gaz, qui sont toujours présents dans l’atmosphère et que l’on peut récolter de façon automatique sur des filtres ou dans des ballons.
Les nuages présentent un caractère évènementiel : ils ne sont pas toujours là ! Bien sûr, il est possible de les échantillonner en avion, comme le font certains de mes collègues. Mais cette méthode est techniquement complexe parce qu’il faut absolument éviter toute contamination de l’échantillon par les moteurs de l’appareil. De plus, les nuages sont constitués de fines gouttelettes (entre 10 et 50 micromètres de diamètre), qu’il faut collecter pour avoir un échantillon liquide suffisant pour faire toutes les analyses. Actuellement, en France, seule la station du puy de Dôme, qui présente une forte occurrence nuageuse (40 % du temps) permet l’étude des nuages.
Notre dispositif n’est pas automatisé, ce qui veut dire qu’un opérateur doit être sur place pour le montage du collecteur, la collecte, le démontage et le traitement de l’échantillon. Nous utilisons un collecteur de nuage baptisé boogie et des protocoles très stricts de nettoyage et de collecte de l’échantillon.

La quantité d’eau dans les nuages varie de 0,3 à 1 g/m3 d’air, ce qui signifie qu’il faut aspirer beaucoup de nuages pour avoir peu de millilitres. C’est un des points limitants de notre analyse : le volume de nuage collecté.
Nos collectes durent rarement plus de deux heures, parce que nous devons tenir compte de la dynamique atmosphérique. Il est bien plus facile d’étudier les caractéristiques d’un échantillon quand l’histoire de la masse d’air est simple, plutôt que quand il résulte de la combinaison de plusieurs masses d’air différentes. Or, plus le temps passe, plus la composition d’un nuage se complexifie, car les composés emportés dans les différentes masses d’air, influencés par des sources différentes (par exemple, marine et anthropique) se mélangent dans le même échantillon liquide. Pour éviter cela, nous limitons donc la durée de collecte à deux heures, par conséquent nos échantillons sont de faibles volumes et la quantité d’analyses que nous pouvons mener est limitée.
Mais, si je résume, le caractère novateur de notre étude, c’est que nous, chasseurs de nuages, avons la chance de travailler sur une matrice environnementale très peu explorée où tout reste à découvrir.
Vous avez été, j’ai cru comprendre, les premiers surpris par les résultats constatés
A. B. : Franchement, pour le bien de notre belle planète verte et bleue, nous espérions ne pas trouver de pesticides dans les nuages !
La première surprise a donc été la détection de ces composés dans tous les échantillons analysés, même les non suspectés, ceux qui ont une masse d’air qui a voyagé en altitude et sur l’océan Atlantique, donc a priori à une distance éloignée des terres où l’on épand des pesticides.
Nous avons donc fait plusieurs vérifications, notamment un croisement avec les mesures d’aérosols présentées par Ludovic Mayer de l’Université Masaryk (Tchéquie) et ses collègues, et nos concentrations se sont révélées plausibles. Les concentrations observées restent cependant faibles, de l’ordre du nano au microgramme par litre.
Après discussions, nous avons décidé de calculer la masse totale de pesticides potentiellement présents dans les nuages qui survolent la France hexagonale. Pour cela, nous avons pris le parti de formuler une hypothèse importante, à savoir que la concentration mesurée dans les nuages puydomois est représentative des nuages de basse altitude présents sur l’ensemble du territoire français. C’est discutable, certes, mais probablement pas si loin de la vérité : les relecteurs de notre publication n’ont d’ailleurs jamais remis en question cette hypothèse. Nous avons ainsi évalué qu’il pourrait y avoir entre 6,4 et 139 tonnes de pesticides présents dans les nuages au-dessus de la France.
Alors, il faut savoir que les nuages contiennent beaucoup d’eau, de l’ordre du milliard de tonnes, mais, personnellement et naïvement, je ne pensais pas trouver des tonnes de pesticides ! C’est cette estimation qui a déclenché le plus de réactions et qui a fait le plus parler, en bien comme en plus critique, mais j’estime que l’essentiel, au-delà des chiffres, est la prise de conscience collective de la pollution que nous apportons dans l’environnement.
En quoi vos travaux sont-ils utiles à notre compréhension de la circulation des pesticides dans l’environnement ?
A. B. : De mon point de vue, cet article montre que la boucle est bouclée : les pesticides sont retrouvés dans l’eau des rivières, des lacs, dans les nappes phréatiques, dans la pluie et… maintenant dans les nuages. L’atmosphère est extrêmement dynamique et transporte ces composés, même s’ils sont faiblement concentrés, dans les endroits les plus reculés de notre Terre et finalement, certains lieux isolés, comme les régions polaires, qui ne devraient pas être impactés directement par la pollution par des pesticides, sont finalement exposés par ces transports longue distance.
Mais l’atmosphère et les nuages en particulier sont aussi un réacteur chimique capable de transformer ces molécules : les rayons du soleil provoquent des réactions photochimiques qui peuvent dégrader ces composés. C’est pourquoi nous retrouvons parfois dans nos échantillons des produits de transformation et non le pesticide d’origine. Il est donc aussi important de comprendre comment ces molécules se dégradent dans l’environnement.
Dans quels sens allez-vous poursuivre vos recherches à la suite de cette publication ?
A.B. : Plusieurs collègues ont témoigné d’un vif intérêt pour les résultats présentés dans cet article. En tant que chimiste, je me dis que six échantillons collectés sur un seul site ne suffisent pas à représenter la variabilité environnementale. Je pense donc que cette étude doit être étendue à un plus grand nombre d’échantillons, et si possible, prélevés sur plusieurs sites ! Malgré tout, je garde espoir de trouver de nombreux échantillons sans pesticides dans les prochains nuages que nous collecterons…
Rédacteur Fetty Adler
Collaborateur Jo Ann
Auteur : Angelica Bianco, chercheuse en Chimie de l’atmosphère, Université Clermont Auvergne (UCA). Cet article est republié du site The Conversation, sous licence Creative Commons.
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.