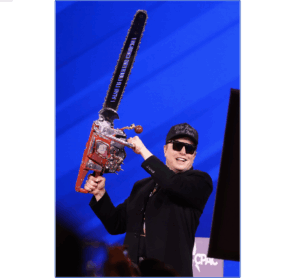Comment la théorie des jeux pourrait expliquer l’amour, la guerre et les accords du monde
Et si le dilemme du prisonnier, qui détermine les différentes hypothèses de scénarios offertes à deux prisonniers pouvait aussi permettre d’envisager qui s’enrichit, qui reste pauvre et pourquoi les guerres ne finissent jamais vraiment ? Cet article est une petite invitation à parcourir, la théorie des jeux, cette branche des mathématiques qui étudie les interactions stratégiques entre les individus.
La vie serait-elle un dilemme du prisonnier dissimulé ?

Pratan, la voix anonyme connue pour ses courts métrages YouTube sur la vie, l’honneur et les principes de la réussite, ne semble pas plaisanter lorsqu’il affirme : « La théorie des jeux sépare les riches des pauvres, la vie de la mort, les gagnants des perdants ». Il n’est d’ailleurs pas le premier à le dire.
Les économistes, les stratèges militaires et les milliardaires de la Silicon Valley sont obsédés par la même idée depuis les années 1950 : la vie serait une série infinie de jeux truqués, et si vous ne comprenez pas la théorie des jeux, vous êtes déjà perdant.
La théorie des jeux se propose d’étudier des situations (appelées « jeux ») où des individus (les « joueurs ») prennent des décisions, chacun étant conscient que le résultat de son propre choix (ses « gains ») dépend de celui des autres, précise l’Encyclopédie Universalis. Cette théorie pourrait servir de base à la stratégie nucléaire de la Guerre froide, les algorithmes de trading de Wall Street et même vos disputes avec votre conjoint.
Le dilemme du prisonnier serait une branche de la théorie des jeux. Il se définit par cette situation : deux suspects sont placés dans des pièces séparées et sont interrogés. Leur choix ? Soit dénoncer, soit rester fidèle.
On se retrouve alors dans trois situations :
- Si les deux se taisent, tout le monde est libéré et s’en va.
- Si l’un dénonce l’autre, l’autre écopera d’une peine.
- Si les deux dénoncent l’autre, les deux écoperont d’une peine, mais moins lourde.
C’est un piège conçu pour révéler les mécanismes de la confiance, de la trahison et de la survie. Le hic est qu’il peut s’appliquer à toute chose : allant de la géopolitique aux applications de rencontre.
Les origines de la Guerre froide : armes nucléaires, nerfs et chiffres

Le dilemme du prisonnier n’est pas qu’une simple hypothèse. Ce dilemme du prisonnier est né en 1950 à la RAND Corporation, un organisme de conseils et de recherche en analyse stratégique de l’armée américaine. C’est dans ce lieu que les mathématiciens Merrill Flood et Melvin Dresher tentaient d’aider les États-Unis à vaincre les Soviétiques (URSS) sans pour autant déclencher une guerre atomique.
Le dilemme du prisonnier est rapidement devenu une métaphore de la Guerre froide elle-même. L’Amérique et l’URSS, enfermées dans des cellules séparées, construisaient toutes deux des armes nucléaires, car aucune ne faisait confiance à l’autre pour garder le silence. Le résultat de cette méfiance ? Des décennies de paranoïa, des milliards de dollars gaspillés et des arsenaux d’armes qui, heureusement, n’ont jamais été utilisés.
Mais alors que présidents et généraux étaient obsédés par la « destruction mutuelle assurée », la même logique s’est infiltrée dans l’économie, la biologie et même dans les algorithmes qui déterminent aujourd’hui les publicités que l’on peut voir sur certains réseaux sociaux.
Les règles du jeu sont-elles truquées ?
Dans la transcription, les « pièces » sont des récompenses symboliques.
- Coopération des deux → 3 pièces d’or chacune.
- Un mouchard → 5 pièces pour le mouchard, zéro pour l’incriminé.
- Deux mouchards → 1 pièce chacun.
Cela paraît simple. Mais si l’on étend ce jeu sur plusieurs tours, comme par exemple dans la vie, en affaires, ou encore dans le mariage, cela se complique. La stratégie gagnante à long terme n’est pas la force brute, mais une stratégie trompeusement douce : celle de la coopération.
C’est pourquoi le tristement célèbre Tournoi de théorie des jeux organisé en 1979, a époustouflé. Organisé par le politologue Robert Axelrod, 40 programmes informatiques différents aux stratégies variées se sont affrontés sur des centaines de simulations.
Le gagnant du tournoi entre programmes informatiques ? Pas le sournois « Joss », qui mouchardait au hasard 10 % du temps. Pas le « Grugger » vengeur, qui ne pardonnait jamais une trahison. Le champion a été l’algorithme le plus simple de tous : celui du comportement CRP, pour Coopération-Réciprocité-Pardon. Commencer gentiment. Imiter son adversaire. Pardonner. Recommencer…
Pourquoi le « Loup solitaire » est une stratégie perdante

Ce qui rend le CRP si dangereux est aussi ce qui le rend humain. C’est dur mais juste : coopératif mais pas naïf. Les mathématiques montrent que l’honneur, du moins lors d’interactions répétées, est plus payant que le déshonneur. Cela vous paraît évident ? Alors, dites-le à la moitié de Wall Street. Ou à tous les influenceurs qui diffusent des vidéos de « mâle alpha, loup solitaire et harcelant » sur Tik Tok.
Dans la transcription, la stratégie offensive, « la stratégie du loup solitaire est une stratégie totalement perdante en théorie des jeux. » La raison ? Les loups solitaires se font éliminer. Alors que la coopération est évolutive. De la même manière que les colonies de fourmis, les meutes de loups ou les logiciels libres prospèrent autour de la confiance, la réciprocité et le partage des bénéfices.
C’est peut-être aussi pourquoi les cercles fermés du pouvoir, des Skull and Bones au groupe Bilderberg, fonctionnent grâce à une coopération maximale à l’intérieur de leurs murs, tout en dépossédant le monde à l’extérieur de leurs cercles.
Honneur à l’intérieur, déshonneur à l’extérieur ?
C’est là que les choses peuvent frôler le complot. Apparemment, les sukas, comme on appelle en Russie les criminels qui coopèrent avec l’administration, pratiquent une version à double face de la théorie des jeux : coopération totale entre eux, exploitation totale des masses. Appelons cela « Honneur à l’intérieur, déshonneur à l’extérieur ».
À un autre niveau, examinons plusieurs approches. Par exemple, la manière dont l’OPEP détermine secrètement les quotas de production pétrolière. Ou encore la manière dont les banques coordonnent les fluctuations des taux d’intérêt. Ou la manière dont les politiciens s’allient aux lobbyistes tout en alimentant la division dans l’opinion publique. La pratique de diviser pour mieux régner n’est pas seulement une stratégie militaire. C’est un moyen pour maintenir une population dans le pire dilemme du prisonnier : ce qui la rend fragmentée, méfiante et incapable de coopérer.
Chaque guerre, chaque panique médiatique, chaque sujet de discorde peut alimenter ce cercle vicieux. Plus une personne se méfie de son voisin, moins elle est susceptible de coopérer , et plus elle risque d’adopter ce que les chercheurs appellent la stratégie du « rancunier » ou de l’« affranchi » : une méfiance totale après une trahison. Et qui en profite ? Certainement pas la personne. Mais, la guerre, ultime bouton de réinitialisation
Si la Guerre froide fut le dilemme du prisonnier le plus long de l’histoire, les guerres chaudes actuelles sont les boutons de réinitialisation. Envoyer des millions de personnes au front, traumatiser des générations entières, fracturer des communautés, et vous avez de fait anéanti la possibilité d’une coopération à grande échelle pour des décennies.
Ainsi, les soldats brisés rentrent chez eux méfiants, cyniques et isolés. Les sociétés perdent leur capacité à jouer franc jeu et tombent dans le piège d’une méfiance permanente. C’est un moyen brutal, mais efficace, de maintenir la désorganisation des populations pendant que certaines élites poursuivent leurs jeux coopératifs à l’intérieur de leur cercle privé.
Somme nulle contre gagnant-gagnant

Au cœur de tout cela se trouve un clivage philosophique :
- Les jeux à somme nulle comme les échecs, le poker, la géopolitique : la victoire de l’un est la perte de l’autre.
- Les jeux à somme non nulle comme les marchés, les écosystèmes, les relations : tout le monde peut en tirer profit.
Mais quel est l’intérêt du jeu à somme nulle ? Peut-être convaincre les masses que la vie est un jeu à somme nulle, tout en profitant discrètement, en coulisses, des bénéfices tirées de la coopération à somme non nulle.
Voyez les choses ainsi : on ne s’enrichit pas en volant la part de son partenaire commercial, mais en faisant grossir le gâteau et en faisant payer les clients pour chaque part. Ainsi, chaque guerre, chaque discours du « nous contre eux », chaque krach boursier ramène les gens à la logique du jeu à somme nulle.
La mise à niveau : le généreux CRP
Alors, quel est le secret ? Les chercheurs ont découvert que la seule stratégie meilleure que le CRP ( Coopération-Réciprocité-Pardon), est le « généreux » CRP. Ce sont les mêmes règles, mais le généreux CRP est10% plus indulgent.
- Pardonner les trahisons occasionnelles.
- Présumer l’erreur avant la malveillance.
- Garder la porte ouverte.
Cela peut paraître facile, mais en pratique, c’est radical. Cela élimine les profiteurs sans sombrer dans des vendettas sans fin. C’est ce qui se rapproche le plus d’une fatalité évolutive : car la coopération l’emporte sur le long terme. C’est pourquoi les biologistes observent des dynamiques de théorie des jeux dans de nombreux domaines. Par exemple, des bactéries échangeant de l’ADN jusqu’aux chauves-souris vampires partageant leur repas de sang.
Le discours de clôture de cette interprétation est presque sectaire : « Soyez honorables. Soyez indulgents. Jouez selon la logique du CRP (Coopération-Réciprocité-Pardon), ou, adopter sa version améliorée, en choisissant le CRP généreux, serait la stratégie la plus efficace pour remporter l’or.»
La théorie des jeux, politique et la tempête qui s’annonce
Où cela nous mène-t-il ? Si la stratégie du suki est absolue – honneur à l’intérieur, déshonneur à l’extérieur – alors chaque crise mondiale serait à la fois réelle et truquée. Guerres, récessions et pandémies ne seraient pas de simples accidents de l’histoire. Ce seraient des soupapes de pression qui maintiendraient le public divisé, cynique et enfermé dans des stratégies perdantes.
Pendant ce temps, au sein des conseils d’administration, des clubs privés et des réseaux d’élite, la coopération prospère : richesses partagées, accords d’initiés, consensus en coulisses. Le jeu est à somme non nulle, mais seulement pour ces joueurs. Ce serait le côté obscur de la théorie des jeux : savoir que la méthode du CRP est optimale n’a aucune importance si l’autre joueur joue à « diviser pour régner » à grande échelle.
Qu’en est-il de la dernière partie du jeu ?

La théorie des jeux était censée demeurer une curiosité de la Guerre froide : un moyen d’éviter l’annihilation nucléaire. Au lieu de cela, elle est devenue le système de relation invisible du monde moderne. Elle gouvernerait tout : la façon dont les nations négocient, dont les entreprises fixent les prix des produits, dont on discute avec son partenaire, dont les réseaux sociaux entraînent tout un chacun à la riposte et à la méfiance.
La question n’est pas de savoir si l’on est dans le jeu. La question est : quelle stratégie est mise sur la table ? Car si une personne est enfermée dans le mode rancunier, convaincue que la trahison est inévitable, elle est déjà en train de perdre. Si au contraire sur la table de jeu c’est le diviser pour mieux régner, il sera difficile d’enlever son épingle du jeu.
Mais si une personne souhaite jouer avec la stratégie du CRP, alors elle devra commencer gentiment, riposter si nécessaire, pardonner et faire simple, elle pourrait bien pirater la matrice et remporter le jeu.
Alors, si suffisamment de personnes le font, le système tout entier bascule. C’est un scénario qui pourrait hanter les élites. C’est pourquoi diviser pour mieux régner reste la plus vieille ruse du monde. Et c’est aussi pourquoi chaque guerre, chaque guerre culturelle, chaque rumeur de complot se résume à une seule chose : empêcher la coopération.
En fin de compte, l’honneur n’est peut-être pas seulement une question de moralité. Il pourrait bien être la stratégie gagnante par excellence.
Rédacteur Charlotte Clémence
Source : The Prisoner’s Dilemma Is Rigged: How Game Theory Explains Love, War, and the World’s Shadow Deals
www.nspirement.com
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.