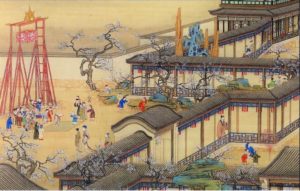L’escalade des guerres inter-étatiques commerciales et l’obsession croissante pour le contrôle des territoires stratégiques sont les deux faces d’une même médaille. Des recherches universitaires récentes révèlent un lien évident entre ces tendances et soulignent la combinaison de politiques qui garantit le mieux la sécurité nationale. Les conclusions sont frappantes et leurs implications pour la trajectoire actuelle du monde sont profondément préoccupantes.
De nos jours, on se souvient d’une époque plus sombre où les grandes puissances n’hésitaient pas à intensifier les tensions militaires pour prendre le contrôle de territoires stratégiquement importants. Pensons à la ruée vers l’Afrique à la fin du XIXe siècle ou à la série de conflits par procuration pendant la guerre froide, et à l’ampleur inimaginable des souffrances humaines qu’ils ont entraînées.
Considérons maintenant la rivalité croissante entre la Chine et les États-Unis au sujet du canal de Panama ou le regain d’intérêt géopolitique pour le Groenland. Un discours courant suggère que le contrôle d’un territoire stratégique renforce la sécurité nationale. Si cet argument est facile à comprendre, il présente toutefois un défaut fondamental : il est tout simplement faux.
Le commerce international, un rempart contre les guerres
Des recherches scientifiques montrent que, historiquement, les principaux points d’étranglement du transport maritime international, tels que le détroit de Gibraltar, le canal de Suez, le canal de Panama et le golfe d’Aden, sont devenus des zones de conflit armé principalement lorsque le commerce mondial était faible.
À l’inverse, pendant les périodes de forte mondialisation, ces passages vitaux avaient tendance à être plus stables et plus sûrs que la plupart des autres endroits. La raison est simple : lorsque le commerce est en plein essor, les enjeux sont suffisamment importants et les grandes puissances ont des intérêts en jeu, elles veillent donc à ce que les routes maritimes restent sûres et accessibles. Le coût d’opportunité imminent d’une perturbation du commerce les oblige à protéger ces artères commerciales vitales.
En d’autres termes, si certains pays peuvent estimer accroître leur sécurité en étendant leur contrôle territorial, l’impact global de tels agissements sur le système international est profondément néfaste. Cela met en évidence une vérité fondamentale sur la guerre et la paix : si la prise de contrôle militaire de zones riches en ressources ou stratégiquement importantes peut offrir un sentiment de sécurité éphémère, la stratégie la plus sûre consiste à promouvoir le commerce international. Des liens économiques solides créent une interdépendance entre des rivaux potentiels, rendant les conflits beaucoup plus coûteux et renforçant les incitations à la paix, un effet confirmé par des études statistiques de pointe.
L’autre face de la même médaille dans les relations internationales est le rôle de la démocratie. Comme le soulignent des travaux universitaires récents, la démocratie n’est pas seulement une garantie contre les guerres civiles ; elle réduit également de manière significative le risque de guerres entre États. Une tendance frappante dans les données, connue sous le nom de « paix démocratique », a même été décrite comme la chose la plus proche d’une « loi » en sciences sociales : les démocraties entrent rarement, voire jamais, en guerre les unes contre les autres, alors que les guerres à grande échelle sont beaucoup plus fréquentes entre deux États autocratiques ou entre une démocratie et une autocratie.

La paix démocratique
La logique derrière cela est simple. Si les autocrates et les élites au pouvoir peuvent tirer un bénéfice personnel de la guerre, la population en général subit des pertes immenses. Des estimations récentes montrent que les guerres entraînent non seulement des milliers de morts, mais aussi, en moyenne, une baisse d’environ 20 % du PIB des pays concernés, la reprise économique étant extrêmement lente.
Conscients de ces conséquences, les citoyens, lorsqu’ils ont la possibilité de s’exprimer, sont généralement réticents à soutenir une agression sans justification convaincante. Et lorsque les deux pays impliqués dans un conflit potentiel sont gouvernés par des électorats peu enclins à prendre des risques, les chances que les différends dégénèrent en guerre deviennent extrêmement faibles.
Sans surprise, l’efficacité de la paix démocratique est particulièrement notable lorsque les gouvernements démocratiques ne sont pas proches de la fin de leur mandat, car les incitations à la réélection maintiennent les actions des gouvernements démocratiques en phase avec les préférences de l’électorat.
Les principes démocratiques, tels que l’État de droit, les freins et contrepoids contre les abus de pouvoir, et la protection des droits politiques favorisent également la paix lorsqu’ils s’appliquent aux relations entre les nations, et pas seulement entre les individus. Une analyse à long terme des conflits internationaux révèle une tendance frappante. Si la Seconde Guerre mondiale et les guerres de décolonisation ont été caractérisées par des affrontements interétatiques extrêmement violents, depuis un demi-siècle les guerres de très haute intensité entre États ont été relativement rares (même si, malheureusement, les guerres civiles se sont multipliées).
Cette ère de paix entre les États a coïncidé avec l’apogée de l’ordre international fondé sur des règles, dans lequel les normes mondiales, telles que l’inviolabilité des frontières souveraines et le droit à l’autodétermination nationale, ont été largement considérées comme sacro-saintes.
Bien sûr, les grandes puissances ont parfois violé ces normes et cherché à influencer les petites nations par des moyens indirects et le revers de la médaille de la raréfaction des guerres interétatiques directes fut un nombre plus élevé de conflits civils par procuration comme au Vietnam ou en Corée.
Cependant, comme l’annexion pure et simple et l’absorption d’États plus faibles ont été largement condamnées, les incitations à déclencher des guerres ont été considérablement réduites. En conséquence, l’âge d’or du multilatéralisme a considérablement diminué l’attrait de la guerre.
Une approche plus transactionnelle de la diplomatie, dans laquelle les grandes puissances utilisent leur influence pour conclure des « accords » ponctuels avec des constellations changeantes d’alliés et d’adversaires, peut apporter des gains à court terme, mais elle crée des vulnérabilités à long terme.
L’histoire nous en offre un exemple éloquent. À la fin du XIXe siècle, l’habileté d’Otto von Bismarck à nouer des alliances a permis à l’Allemagne de rester à l’écart des grands conflits. Cependant, après son renvoi, le leadership impulsif et erratique de l’empereur Guillaume II a conduit l’Allemagne à s’aliéner rapidement ses principaux alliés, laissant le pays de plus en plus isolé et exposé au début du XXe siècle. Cette dissolution des alliances a été un facteur crucial dans la chaîne d’événements qui a conduit à la Première Guerre mondiale.
Si l’histoire peut nous servir de guide, s’emparer de territoires stratégiquement importants et abandonner des alliés de longue date pour des avantages éphémères ne garantit ni la paix ni la prospérité. Une stratégie bien plus sage consiste à investir dans le multilatéralisme, à renforcer les relations commerciales et à défendre un ordre international fondé sur des règles.
Rédacteur Charlotte Clémence
Auteur
Dominic Rohner : Professor of Economics and André Hoffman Chair in Political Economics and Governance, Geneva Graduate Institute, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID). Cet article est republié du site The Conversation sous licence Creative Commons.
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.