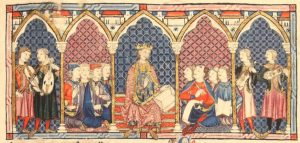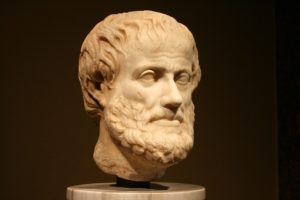Les sophistes étaient des orateurs et des enseignants de la Grèce antique. Ils avaient une remarquable maîtrise de la parole et enseignaient, contre rétribution, l'art de la rhétorique, le droit et la politique. Ils recherchaient l'efficacité du discours beaucoup plus que la vérité, ce qui leur valut de sérieuses critiques.
Ils venaient de différentes régions de la Grèce antique et enseignaient dans l'espace public ou dans les riches villas athéniennes. Leur ambition était de former les jeunes et riches athéniens à briller en société, à exercer le pouvoir ou administrer les affaires publiques.
Des maîtres de la persuasion dans la Grèce antique
Les sophistes n'hésitaient pas à remettre en question les fondements traditionnels de la vérité et de la morale. Ils furent souvent controversés et considérés comme opportunistes, charlatans ou corrupteurs par des philosophes comme Socrate ou Platon. Ce qui donna au sophisme une connotation péjorative.
Malgré ces controverses, les sophistes eurent une influence chez les penseurs de la Grèce antique. Selon l'article Les sophistes de la Grèce antique : sages ou corrupteurs ? du site JePense.org, « l’apport des sophistes grecs reste fondamental : en questionnant le pouvoir des mots et du langage, ils nous rappellent que la parole n'était jamais neutre, toujours sous-tendue par les intérêts de celui qui la véhicule ».

Ils contribuèrent à développer des techniques oratoires et une analyse argumentée. La rhétorique était l'art de parler pour captiver et convaincre ses auditeurs. Si ces techniques et cet art étaient pratiqués par des personnes peu vertueuses, alors la tromperie pouvait se manifester aussi dans les discours.
La vérité était toute relative et secondaire pour certains sophistes et ce relativisme pouvait conduire au nihilisme. Alors pourquoi ne pas jouer avec les mots et les concepts ? C'était ce que dénonçait Platon : la pensée et les discours de certains sophistes pouvaient présenter un risque pour les individus, pour l'ordre social et la démocratie.
Antiphon, surnommé le « cuisinier du discours », avait des capacités de langage exceptionnelles
Antiphon était un sophiste du Ve siècle av. J.-C. Il écrivait des plaidoyers pour ses clients sans plaider lui-même. Il fut considéré comme le fondateur de l'éloquence judiciaire et il fut le premier sophiste dont les discours furent publiés.
Il y avait différents courants de pensée chez les sophistes. Antiphon était partisan d'un hédonisme raisonnable. Il disait : « Il n'y a pas de plus sûr moyen de juger si un homme est raisonnable, que de voir s'il ferme son cœur aux plaisirs immédiats et se montre capable, en se maîtrisant, de remporter une victoire sur lui-même. Au contraire, celui qui veut, sur-le-champ, satisfaire ses désirs, veut le pire au lieu du meilleur », rapporte Jean-Philippe Catonné dans son article Antiphon, sophiste et psychotérapeute, sur le site olivierdouville.com.
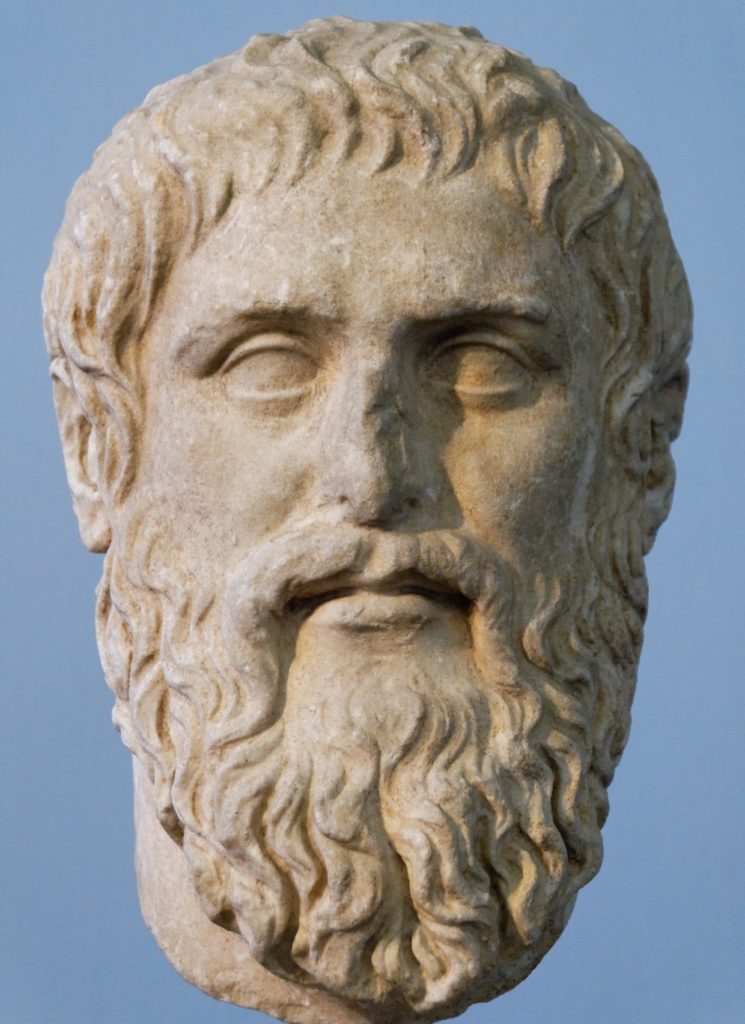
« Antiphon est le seul grand sophiste dont Platon ne parle pas » affirme Jean-Philippe Catonné, alors que le célèbre philosophe en critiquait fortement certains autres. Ce sophiste avait plutôt une vision positive du monde et prônait l'amitié et la concorde entre les hommes.
Par ailleurs, il inventa une méthode d'interprétation des rêves et une « thérapie de l'âme » fondée sur le discours. Il connaissait l'influence de l'esprit sur le corps. Ainsi affirmait-il que « la pensée gouverne le corps, aussi bien pour la santé et la maladie que pour le reste ». Il disait guérir le mal-être psychosomatique par l'expression verbale des sentiments et l'interprétation rationaliste des rêves. Certains en font un des précurseurs de la psychanalyse.
Le reproche à Socrate d'enseigner gratuitement
Xénophon, historien, philosophe et ami de Socrate, raconte dans son œuvre « Mémoires sur Socrate », trois échanges entre Antiphon et Socrate. Ces conversations mettent en lumière le désaccord entre Socrate et les sophistes grecs, notamment au niveau de la rétribution financière.
Le sophiste reprochait à Socrate d'enseigner gratuitement. Il l'aborda un jour avec l'intention secrète de lui prendre ses disciples. En leur présence, il demanda à Socrate pourquoi vivait-il de telle sorte qu'aucun esclave ne voulait le servir, pourquoi buvait-il et mangeait-il aussi frugalement, pourquoi portait-il toujours le même vêtement et marchait-il pieds-nus ? Il le questionna encore sur son refus de recevoir une rétribution financière qui lui permettrait de vivre avec plus d'indépendance et de douceur.

Il lui déclara en outre : « Si donc, à la manière des autres maîtres, qui forment leurs disciples à leur ressembler, tu instruis ainsi les tiens, tu peux te considérer comme un professeur de misère. » En réponse, Socrate proposa à Antiphon d'examiner ensemble sa vie qui lui paraissait si pénible et si dévalorisante.
Tout d'abord, il demanda au renommé sophiste si, sans salaire, il devait tout de même se mettre au service de personnes qu'il n'appréciait guère, ou alors avait-il la liberté de refuser ? Concernant son alimentation, il lui dit qu'il mangeait peu et très simplement et donc qu'il mangeait toujours avec appétit, sans même avoir besoin d'assaisonnements. De même, buvant seulement quand il avait soif, l'eau lui était toujours délicieuse.
Loin des désirs humains, plus près de l'état divin
Socrate parla ensuite de sa tenue vestimentaire. Il dit qu'habituellement les gens changeaient de vêtements à cause du froid ou de la chaleur, et qu'ils portaient des chaussures pour se protéger des blessures en marchant. Il expliqua que le froid et la chaleur n'avaient plus d'emprise sur lui, car il avait entraîné son corps à supporter toutes les conditions du climat. Il ne recherchait plus ni la chaleur d'une maison en hiver, ni l'ombre d'un arbre en été. Un mal de pieds ne l'avait jamais non plus empêché d'aller là où il voulait.

Il posa cette question à Antiphon : « Si je ne suis point esclave de mon ventre, du sommeil, de la lubricité, penses-tu qu’il y en ait une cause plus puissante que l’expérience de plaisirs plus doux, lesquels ne flattent pas seulement à l’instant même, mais font espérer des avantages continuels ? » Il lui affirma qu'il y avait un bonheur plus intense et durable que celui d'un plaisir ou d’un succès éphémère ou d'une réussite professionnelle, c'était l'espoir de se rendre meilleur soi-même et de rendre meilleurs ses amis.
Qui avait le plus de loisir à servir ses amis ou sa patrie, celui qui se contentait des choses les plus simples, ou celui qui recherchait le bonheur dans les délices et la magnificence ? Les divinités n'avaient besoin de rien et elles étaient la perfection même. Moins on avait de besoins, plus on se rapprochait de l'état divin et de la perfection.
Vertu et sagesse ne peuvent se monnayer
Antiphon revint à la charge un autre jour. Il lui dit qu'il le croyait juste mais pas tout-à-fait sage, car lui, Socrate, connaissait bien la valeur pécuniaire de toute chose et s'il ne faisait pas payer ses leçons, c'est qu'il estimait son savoir et sa sagesse sans valeur. Socrate répondit « qu’on peut faire de la beauté comme de la sagesse un emploi honnête ou honteux »
Connaître un bel homme épris de vertu et vouloir s'en faire un ami était admirable, mais peut-être certains voulaient-ils en tirer profit de manière dégradante. Socrate visa plus précisément Antiphon : « Il en est de même de la sagesse : ceux qui en trafiquent avec qui veut la leur payer, s’appellent sophistes ou bien prostitués ; mais celui qui, reconnaissant dans un autre un bon naturel, lui enseigne tout ce qu’il sait de bien et s’en fait un ami, on le regarde comme fidèle aux devoirs d’un bon citoyen ».

Antiphon, une autre fois, le questionna sur sa réelle connaissance en politique et sur sa prétendue capacité à rendre les autres habiles dans ce domaine, alors qu'il ne s'occupait pas lui-même d'affaires publiques. En réponse, Socrate lui demanda ce qui valait le mieux, de s’occuper tout seul de politique ou de se consacrer à rendre un grand nombre de gens capables de s’en occuper ?
Certains étaient heureux d'avoir un bon cheval, un chien ou un oiseau. Socrate, lui, était heureux d'avoir de bons amis, de leur apprendre de bonnes choses et de les aider à devenir vertueux. Avec ses amis, il parcourait les livres des anciens sages et ils y découvraient des trésors d'enseignements. Ils en recueillaient le meilleur. Ils regardaient comme un bienfait inestimable de pouvoir être utiles les uns aux autres.
Xénophon confia qu'en entendant ces conversations, il croyait volontiers que Socrate était heureux et qu'il conduisait ses auditeurs à la vertu.
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.