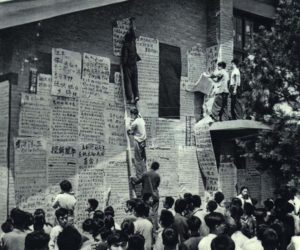Les côtes bretonnes connurent dans les années 1976 à 1980 une série de marées-noires avec six naufrages de pétroliers. Après le naufrage, sur la côte nord du Finistère, de l'Amoco Cadiz en 1978 et l'énorme pollution pétrolière engendrée sur le littoral breton, des mesures importantes allaient enfin être prises pour sécuriser une route maritime très fréquentée mais dangereuse.
Des remorqueurs de grande puissance pour tirer les plus lourds navires et affronter les plus grosses tempêtes des côtes bretonnes
Les bateaux abordant la Manche ou descendant vers l'Atlantique, furent tenus de respecter, à partir des années 80, les trajectoires précises de deux voies, appelées « le rail d'Ouessant », l'une montante, l'autre descendante, bien délimitées comme des voies d'autoroute. Les aiguilleurs de la mer dans la tour de surveillance de l'île d'Ouessant contrôlaient désormais à l'aide de radars la route des bateaux, particulièrement sur cette route maritime la plus fréquentée du globe avec un trafic quotidien de 150 navires, dont des superpétroliers et des porte-conteneurs géants, entre autres.

Le bateau remorqueur Abeille Flandre déjà en service en 1979, puis l'Abeille Bourbon en 2005 (renommé Abeille Bretagne en mai 2025) ont été, avec leurs marins, depuis le début des années 1980, des éléments essentiels du dispositif mis en place pour diminuer les risques de collisions et de naufrages qui ont lieu principalement lors de tempêtes et éviter d'autres désastres écologiques.
« Les vrais marins sont modestes, ils savent que la mer est la plus forte. Ici, à Ouessant, ils sont plus modestes encore parce qu'ils se méfient et ils ont raison de se méfier. (…) À la croisée des mers où l'océan vient s'étrangler, les vents sont plus sauvages, les courants plus furieux, les brisants plus aigus », annonce Hervé Hamon dans son documentaire Chasseurs de tempêtes, du média Ici et ailleurs, voyage.
Hervé Hamon embarqua en 1998 avec les douze marins à bord de l'Abeille Flandre, lors de deux sauvetages. Pourquoi n'y avait-il plus eu de catastrophe majeure sur les côtes bretonnes depuis vingt ans ? Il voulait répondre à cette question. Il recueillit et partagea à travers un documentaire vidéo le témoignage et l'expérience de ces marins exceptionnels.

On se détend en ville... mais le bip retentit : appareillage dans dix minutes !
L'Abeille était en alerte depuis trois jours, car dès que le vent souffle au-delà de 40 km/h, le remorqueur quitte son port d'attache, Brest, pour rejoindre son mouillage d'Ouessant, au plus près de « l'autoroute des cargos » et autres monstres d'acier, gagnant ainsi deux heures pour atteindre un navire en détresse.
Ce jour-là, l'équipe des veilleurs du sémaphore de Ouessant, à 11h40, signale qu'un pétrolier de 180 m, le Capraia, quitte la trajectoire du rail montant et s'approche de l'île d'Ouessant. Le commandant du puissant remorqueur, Carlos (Charles Claden) prévient le Centre des Opérations Maritimes qu'il y a une urgence extrême. Pour le moment, le comportement du Capraia est incompréhensible.
Au moment de l'alerte, trois mots, trois regards et chacun des douze marins sait ce qu'il doit faire. Chacun sait qu'il est nécessaire aux autres. L'appareillage s'est fait en dix minutes. Débordant la pointe qui l'abritait de la tempête, l'Abeille Flandre fonce vaillamment vers le Capraia, au travers des vagues courtes et hargneuses, qui prennent de plein fouet la proue du bateau et s'abattent sur les vitres de la passerelle de navigation, à 15 m au-dessus du pont. La vitesse est de 25 km/h. L'Abeille en a vu d'autres, il est le seul à pouvoir sortir dans des conditions extrêmes, quand tous les autres s'abritent ou fuient.

Le Capraia apparaît maintenant sur le radar du remorqueur, et les marins commencent à comprendre. Son commandant en a eu assez d'encaisser continuellement un terrible roulis en travers de sa route. Alors il a enfreint les règles et modifié son cap, pour prendre les vagues par derrière et fatiguer moins, sans penser que le vent le rabattrait sur l'île et les côtes bretonnes.
« À la passerelle de l'Abeille, guettant l'écho du radar, on est partagé entre la rage et la crainte, mais la règle absolue est de ne pas céder à l'excitation. On garde son adrénaline pour soi, c'est obligatoire et nécessaire », explique Hervé Hamon, ajoutant : « Il faut imaginer les dangers du dessous, les montagnes que la mer cache et qui déchirent les coques, sournoisement ».
Ces hommes savent-ils qu'ils jouent avec la mort ?
Le commandant du Capraia doit sans doute ignorer que la petite île de Keller, bien visible, est prolongée par une longue chaussée sous-marine sur laquelle il est tout près de fracasser la coque du navire.
Heureusement, pour cette fois-ci il vient de passer de justesse. Mais Carlos sait qu'il n'est pas encore au bout de ses peines, car le pétrolier s'obstine à vouloir longer la côte. Plus loin ce sont les rochers de Portsall qui l'attendent, là où s'éventra en mars 1978 l'Amoco Cadiz avec ses 227 000 tonnes de pétrole brut. Carlos calcule la dérive, estime l'effet des courants et avertit les aiguilleurs de la mer à Ouessant du danger imminent.

La manœuvre reste simple à ce stade, le pétrolier n'a qu'un coup de barre à donner sur la gauche et il serait sauf. L'aiguilleur d'Ouessant va alors s'adresser au délinquant avec un courtoisie délibérée. « C'est pour information qu'il lui signale les dangers qui l'attendent et il lui demande de regagner si possible, le tracé du rail. Cette retenue quand tout le monde aurait envie d'insulter l'irresponsable, est le fruit d'un calcul et d'une expérience. Il est inutile de se défouler. On prend soin de ne pas provoquer, chez le commandant du bateau dangereux, un réflexe de vanité blessée. La fonction de l'Abeille n'est pas de faire la police, elle consiste à préserver, escorter, sauver », indique Hervé Hamon.
Le commandant du Capraia, au bout de longues minutes d'échange avec l'aiguilleur, prend conscience de son erreur fatale. Il obéit enfin et s'engage à faire de son mieux. Il doit deviner aussi que l'amande, à la première escale, sera salée. C'est pourquoi il file doux maintenant. Sur l'Abeille, les marins n'en pensent pas moins, mais le résultat est là et c'est le résultat qui compte. Selon la formule de Carlos : « La bonne manœuvre est celle qui réussit ». Il n'y a pas eu de remorquage, rien de spectaculaire, mais la connaissance précise des côtes bretonnes, l'esprit concentré et persuasif des marins face à un commandant inconscient du danger, a bel et bien permis d'éviter une nouvelle catastrophe.
Carlos, pour bien terminer le travail d'aide au pétrolier, est entré directement en contact avec le commandant maltais pour lui expliquer les dangers qui pouvaient encore survenir s'il ne prenait pas dix degrés de plus sur sa gauche. En continuant la conversation, Carlos a appris que le commandant ne possédait qu'une carte au 200 000ème, sur laquelle on ne distinguait ni les chenaux, ni les courants, ni les roches. A cause d'une carte trop imprécise et d'une faute grave d'itinéraire, un tanker a failli sombrer à nouveau sur les rochers de Portsall.

Le courage exceptionnel des marins de l'Abeille Flandre
Le second sauvetage allait être beaucoup plus physique et allait révéler tout le savoir-faire et le courage des marins à bord du remorqueur. Le mardi 13 janvier vers 14h, le porte-conteneur Nautila demande du secours. Il est en avarie complète de machines à l'ouest de l'île de Sein. Le vent et le courant lui permettent encore de tenir, mais l'un et l'autre vont bientôt changer de direction et le naufrage sera alors inévitable. C'est une course contre la montre, le vent commence déjà à tourner.
Avant d'approcher le navire en détresse les marins font le point et arrêtent une tactique pour passer à l'action. Le bosco Lionel (maître de manœuvre) règne sur le pont, territoire de tous les dangers. Le lieutenant Dominique est chargé de la coordination avec la passerelle. C'est lui aussi qui lancera, aux matelots du porte-conteneurs, un fin cordage au bout duquel sera attaché le câble de remorquage (la remorque). Sur la plage arrière, contre un vent de force dix et des paquets de mer imprévisibles, la combinaison tout temps est la seule armure. Le reste est une question de vigilance et de réflexe pour ne pas disparaître dans l'océan en furie.
Un marin témoigne des risques extrêmes que prennent les hommes travaillant sur le pont. Quand un paquet de mer s'abat sur le pont, si on a pas eu le temps de s'abriter derrière le treuil, il faut impérativement s'accrocher aux « mains courantes » ou à tout autre objet bien ancré au navire. Bien souvent alors on fait « drapeau », le corps part à l'horizontal avec la déferlante, seulement retenu par les mains ou les bras !

Lionel et Jean-Marc, le second maître, forment un duo bien rôdé pour préparer la remorque. Chacun sait par cœur ce qu'il doit faire et garde un œil sur une éventuelle vague déferlante. Ils ont vu toutes sortes de bateaux en détresse, les gestes des sauveteurs ne changent pas mais chaque sauvetage est différent. Le commandant du Nautila est sérieux, il a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour le remorquage. La mise en demeure du préfet maritime, signifiée à 15 h, n'a posé aucun problème.
Maintenant, c'est au lieutenant Dominique de viser juste pour lancer le cordage. La partie peut mal tourner car les deux coques dansent deux ballets différents mais très rapprochés. L'équipage du Nautila, très performant à l'avant du bateau, ne laisse pas filer l'occasion, la première tentative est la bonne. Carlos sur la passerelle à l'abri des vitres, ne quitte pas son porte-voix. Lui aussi a travaillé sur le pont quand il était lieutenant, il en connaît tous les périls. Il a une obsession toujours présente, la hantise de perdre un homme. Cela peut arriver à tout moment. La remorque, c'est un câble d'acier de quelques centimètres de diamètre seulement, mais cela requiert des treuils géants et déplace des montagnes de métal dans la tempête. S’il cède, il peut tuer en balayant le pont !
Bientôt le Nautila est rattaché à l'Abeille Flandre. Carlos et Guitou manient avec dextérité le puissant remorqueur. La remorque a maintenant beaucoup de longueur, elle est en grande partie immergée, ce qui tient lieu d'amortisseur et adoucit les chocs. Le Nautila suit docilement l'Abeille à rythme soutenu, le commandant est pressé de mener le bateau à bon port avant que la mer ne soit plus hargneuse. Tous les navires connaissent des pannes. On stoppe, on répare pendant quelques heures et on peut repartir. Mais dans les environs de Ouessant, il n'y a pas assez de temps pour réparer car la houle est trop forte et la dérive trop rapide. Le rail sert justement à repousser les cargos assez loin, pour qu'un remorqueur ait le temps de les secourir.

Le palmarès des remorqueurs, la solidarité et la modestie des marins
Les remorqueurs Abeilles remplissent des missions de service public. Au COM, Centre d'Opérations Maritimes, Hervé Hamon put interroger l'Amiral Le Dantec, celui qui patronnait toute la flotte française de l'Atlantique en 1998.
« L'Amoco Cadiz a été une prise de conscience générale de l'urgence de mesures à prendre. Là, on ne peut pas accuser les pouvoirs publics d'être restés les bras ballants. On a donné aux préfets maritimes des pouvoirs considérables, notamment, celui de mise en demeure d'un bateau constituant un danger pour le littoral français. Dans ce cas, on demande à l'armateur et au capitaine du navire de faire cesser le danger qu'il représente. Faute de quoi, à ses frais et à ses risques, nous prendrons toutes les mesures pour empêcher que le bateau provoque une catastrophe », explique l'Amiral.
Il précise, concernant la mise en demeure : « ... l'accident de l'Amoco Cadiz, c'est ça qui s'est produit. Les négociations interminables entre le commandant du bateau, son armateur et les compagnies de remorquage. Aujourd'hui, la mise en demeure me permet d'obliger un bateau à prendre la remorque. La loi française m'autorise à le faire et nous avons l'Abeille Flandre qui est capable, elle l'a prouvé, de tenir, même par très mauvais temps, un gros pétrolier en difficulté ».

Après 20 ans de service autour des côtes bretonnes, l'Abeille Flandre avait sauvé 176 navires, dont onze pétroliers, sept transporteurs chimiques, deux ferries et 37 chalutiers. L'Abeille Languedoc, basé à Cherbourg, avait un palmarès comparable. Une mise en perspective confirme le bon choix : le coût de la seule catastrophe de l'Amoco Cadiz représentait 120 années d'affrètement du remorqueur !
Après le deuxième sauvetage dont il fut témoin sur l'Abeille Flandre, Hervé Hamon demanda à Carlos : « Quand tu lis dans un journal que vous êtes des héros, tu réagis comment ? » Carlos répondit simplement, sans parler de lui : « Je pense que les gars le méritent, ils n'osent pas en parler. C'est vrai, quand je suis là-haut, je vois ce qu'il font. Ce sont de toutes petites personnes au milieu de l'eau. À des moments, quand on a un gros paquet de mer qui embarque, je ne vois plus personne, j'ai l'impression que je les ai tous perdus, mais ils sont toujours là et ils retournent derrière. Je crois qu'ils le méritent ».
Quand il posa la question aux autres marins de l'équipage eux-mêmes, cela les fit rire ou sourire. Certains admettaient que c'était un travail exceptionnel, mais s'empressaient d'ajouter, par modestie et respect pour les autres, qu'il y avait partout des gens exceptionnels et des métiers exceptionnels.
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.