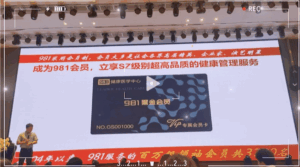Partout dans le monde, les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. L’espérance de vie moyenne mondiale est d’environ 74 ans pour les femmes et 68 ans pour les hommes. En France, en 2024, elle était de 85,6 ans pour les femmes, bien supérieure à celle des hommes, qui était, elle, de 80,0 ans. Cette tendance à la longévité se vérifie dans la plupart des pays et à travers les siècles, et même chez la plupart des espèces de mammifères.
Une équipe internationale, dirigée par des scientifiques de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive (MPI-EVA), en Allemagne, avec 15 co-auteurs du monde entier, a réalisé l’analyse la plus complète à ce jour des différences de durée de vie entre les sexes chez les mammifères et les oiseaux. L’équipe de chercheurs a utilisé des méthodes scientifiques pour étudier les causes évolutives, biologiques et environnementales. L’étude publiée dans la revue Science Advances révèle un schéma aussi cohérent qu’inattendu.
En analysant les écarts de longévité chez plus de 1 176 espèces - dont 528 mammifères et 648 oiseaux - les chercheurs ont découvert des indices permettant d’élucider l’une des énigmes les plus anciennes de la biologie : pourquoi les mâles et les femelles vieillissent différemment.
Les comportements à risque raccourcissent la vie
Cette observation commune a suscité depuis longtemps la perplexité des scientifiques, qui ont tenté de l’expliquer en mettant en avant les comportements à risque plus fréquents chez les hommes, notamment le tabagisme et la consommation d’alcool. Bien que les écarts se soient resserrés, ils restent importants.
« Les hommes sont également plus susceptibles que les femmes de mourir d’alcoolisme, de toxicomanie, de suicide et d’homicide », explique Alan Geller, maître de conférences en sciences sociales et comportementales à la Harvard T.H. Chan School of Public Health.
Alan Geller étudie les disparités entre les décès dus aux maladies cardiaques et au cancer chez les hommes et les femmes. Comme les hommes sont plus susceptibles de fumer du tabac, ils meurent plus souvent d’un cancer du poumon. Le tabagisme augmente également le risque de maladies cardiaques. C’est un exemple clair de la façon dont les comportements à risque peuvent réduire l’espérance de vie. Il existe certains facteurs que les hommes ne peuvent pas contrôler. Par exemple, l’œstrogène a un effet protecteur sur le cœur.
Au-delà du facteur biologique, le fait que les hommes soient moins susceptibles de se protéger du soleil, les exposent à un risque de décès plus élevé. D’après une enquête réalisée par la FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté) et OpinionWay en 2022, les plus réfractaires à appliquer une protection solaire sont les hommes (27%).

Les hommes meurent beaucoup plus souvent du mélanome. En France, le mélanome a été responsable en 2018 de près de 2 000 décès, dont 57 % sont dénombrés chez l’homme, ce qui représente 1 % des décès par cancer.
« C’est fascinant, car le taux d’incidence du mélanome est légèrement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, mais le taux de mortalité lié au mélanome est beaucoup plus élevé chez les hommes », explique Geller. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment biologiques. Selon l’American Academy of Dermatology Association, la peau des hommes est différente. Elle a tendance à être plus épaisse et contient plus de collagène et d’élastine, des fibres qui donnent à la peau sa fermeté.
Des recherches montrent que ces différences peuvent rendre la peau plus vulnérable aux dommages causés par les rayons ultraviolets du soleil.
De plus, les hommes sont moins enclins à se faire dépister pour le cancer. « Ils sont moins susceptibles d’aller chez le médecin pour demander un examen de dépistage du cancer de la peau ou d’examiner leur propre peau », explique Geller. « Vous avez donc un double handicap », ce qui augmente leurs risques.
Cependant le tableau restait incomplet.
Longévité et génétique
L’une des explications de l’écart entre les sexes en matière d’espérance de vie semble résider dans la génétique, plus précisément dans les chromosomes sexuels.
Chez les mammifères, les femelles possèdent deux chromosomes X, contre un X et un Y pour les mâles, ce qui peut constituer une « protection ». Si un chromosome X est porteur d’une mutation nocive, le second chromosome X peut souvent compenser, réduisant ainsi le risque de maladie ou de problèmes de développement. Les mâles, en revanche, ne disposent pas d’une telle réserve. Avec un seul chromosome X, toute mutation nocive peut être plus préjudiciable et potentiellement réduire la durée de vie. Ce concept est connu sous le nom Hypothèse du sexe hétérogamétique.
Mais chez les oiseaux le système est inversé : les femelles portent deux chromosomes différents (Z et W), tandis que les mâles, eux, sont ZZ. Dans ce cas précis, ce sont bien les femelles qui sont susceptibles d’être désavantagées en termes de durée de vie.
En accord avec ces observations, l’étude révèle que chez la plupart des espèces de mammifères (environ 72 %), les femelles vivent plus longtemps, avec une moyenne de 12 %. Pourtant, chez la majorité des espèces d’oiseaux (environ 68 %), ce sont les mâles qui connaissent une longévité plus importante, avec un avantage moyen de 5 %. Cependant, l’étude montre certaines variations intéressantes.

« Certaines espèces ont montré le contraire du schéma attendu », a déclaré Johanna Stärk, co-auteure de l’étude et anthropologue à l’Institut Max Planck. « Les rapaces sont à l’opposé de tout ce que nous observons ailleurs ». Ainsi, les femelles, particulièrement agressives, jouent aussi un rôle de défense du territoire et de protection et vivent pourtant plus longtemps que les mâles. Les chromosomes sexuels ne peuvent donc expliquer qu’une partie du phénomène.
Ces résultats suggèrent que les chromosomes sexuels sont effectivement un facteur déterminant dans les différences de durée de vie, mais qu’ils ne sont pas les seuls responsables, au regard du nombre d’exceptions. Il est clair que d’autres forces sont à l’œuvre.
Un monde de compétition acharnée entre les mâles
Les données de l’étude corroborent l’hypothèse selon laquelle les stratégies reproductives sont également en cause.
Ainsi, chez les mammifères polygames où la concurrence pour les partenaires est intense, les mâles meurent généralement plus tôt que les femelles. Par exemple, les lions mâles, à l’âge adulte, se battent violemment et meurent souvent plus jeunes que les lionnes. Chez les babouins et les gorilles également, les mâles survivent souvent au-delà de leur utilité reproductive et succombent à des blessures ou aux coûts cumulés de la compétition plus tôt que les femelles.
En comparaison, de nombreux oiseaux sont monogames, ce qui réduit la pression concurrentielle, ils vivent environ 5 % plus longtemps que les femelles.
Selon Nicole Riddle, biologiste à l’Université de l’Alabama : « En raison de cette compétition, les individus - en général les mâles - investissent dans des traits favorisés par la sélection sexuelle, comme une grande taille corporelle, des bois impressionnants ou un plumage ornemental. Ces traits sont coûteux à produire, et la lutte pour la reproduction entraîne souvent des combats avec d’autres mâles ».
Dans l’ensemble, les différences de longévité sont les plus faibles chez les espèces monogames, tandis que la polygamie et les différences de taille prononcées sont associées à un avantage plus important pour les femelles.
La sélection sexuelle est donc un facteur clé qui façonne les différences de durée de vie entre les espèces. Mais, ce n’est pas le seul.
La vie au zoo et la persistance de l’écart
Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que des phénomènes naturels tels que la prédation, les agents pathogènes ou les climats rigoureux étaient à l’origine des écarts de longévité entre les mâles et les femelles.
Pour tester cette théorie environnementale, les chercheurs se sont intéressés aux populations des zoos, où les animaux vivent dans des conditions contrôlées et protégées.
Les résultats sont frappants. Même dans les zoos, les différences de durée de vie entre les sexes persistent. Les écarts sont parfois moins importants que dans la nature, mais ils disparaissent rarement complètement.
Cette comparaison avec les zoos reflète la situation de la longévité humaine, puisque les progrès de la médecine et l’amélioration des conditions de vie ont réduit, sans toutefois l’éliminer complètement, l’écart en matière d’espérance de vie.
Les aidants vivent plus longtemps
L’étude souligne que le sexe qui investit le plus dans l’éducation de sa progéniture a tendance à vivre plus longtemps. Chez les mammifères, ce sont généralement les femelles qui supportent la plus grande partie du fardeau : la grossesse, l’allaitement et, chez de nombreuses espèces, la majeure partie des soins. Chez les espèces longévives telles que les primates, cet avantage maternel est particulièrement prononcé.
Cette tendance vaut également pour les humains. Les femmes, qui assument souvent le rôle d’aidante, pourraient bénéficier des effets émotionnels et physiologique d’un comportement nourricier, ce qui peut contribuer à réduire le stress et améliorer la santé globale.
Une durée de vie plus longue chez les femelles garantit ainsi que les mères survivent suffisamment longtemps pour que leurs enfants atteignent l’indépendance.

Un autre phénomène lié à « l’hypothèse de la grand-mère » pourrait expliquer pourquoi les femmes vivent souvent bien au-delà de leur âge de reproduction : les femmes âgées augmentent les chances de survie de leurs petits-enfants, contribuant ainsi indirectement à la survie de leurs gènes. Ce qui peut aider à expliquer pourquoi les femmes jouissent souvent d’une durée de vie plus longue que les hommes.
Chez les oiseaux, la situation est parfois différente. De nombreuses espèces se partagent les tâches parentales, et chez certaines, les mâles s’investissent même davantage que les femelles dans l’éducation de leurs petits. Cet engagement plus important des mâles correspond à l’observation selon laquelle, chez de nombreuses espèces d’oiseaux, les mâles vivent plus longtemps que les femelles.
Les racines du vieillissement
Cette étude met en évidence une vérité profonde : les différences de durée de vie entre les sexes ne sont pas aléatoires. Elles sont modelées par la génétique, la sélection sexuelle, les soins parentaux et les stratégies reproductives. Ces facteurs interagissent de manière complexe, produisant des schémas récurrents chez toutes les espèces et qui perdurent en dépit des changements environnementaux.

« Il existe encore des différences très fortement codées - physiologiques et génétiques - entre hommes et femmes », rappelle Fernando Colchero. « Qui sait jusqu’où la médecine nous emmènera, mais en général, nous ne nous attendons pas à ce que ces écarts disparaissent complètement. »
Tenter de comprendre pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes n’est pas seulement un exercice académique. Cette question a des implications pratiques pour la santé, la médecine et la planification sociale. Le vieillissement général des populations, le fait que les femmes vivent généralement plus longtemps a des effets profonds sur les systèmes de soins, de retraite et de santé.
En outre, en étudiant les différences entre les sexes en matière de vieillissement, les chercheurs pourraient découvrir de nouveaux traitements pour les maladies liées à l’âge, ce qui serait bénéfique pour les deux sexes.
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.