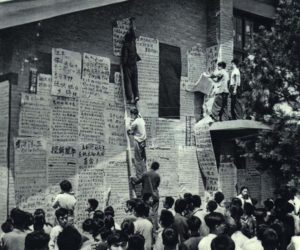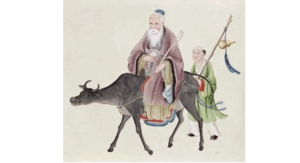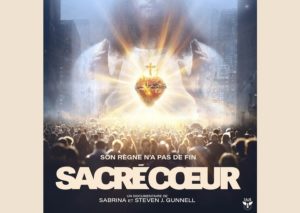Depuis 1970, 73 % de la faune mondiale a disparu, tandis que la population mondiale a doublé pour atteindre 8 milliards d’individus. Les recherches montrent que ce n’est pas une coïncidence, mais que la croissance démographique entraîne un déclin catastrophique de la biodiversité. Pourtant, un tournant dans l’histoire de l’humanité est en cours. Selon les projections de l’ONU, la population de 85 pays diminuera d’ici 2050, principalement en Europe et en Asie, en particulier au Japon.
D’ici 2100, la population mondiale sera en voie de déclin. Certains affirment que ce sera bénéfique pour l’environnement.
En 2010, le Japon est devenu le premier pays d’Asie à entreprendre un processus de dépeuplement. La Corée du Sud, la Chine et Taïwan suivent de près. En 2014, l’Italie a été la première en Europe du Sud, suivie par l’Espagne, le Portugal et d’autres. Nous qualifions le Japon et l’Italie de « pays précurseurs en matière de dépeuplement » en raison de leur rôle de précurseurs dans la compréhension des conséquences possibles dans leurs régions.
Étant donné que l’on suppose que le dépeuplement pourrait contribuer à la restauration de l’environnement, nous avons travaillé avec nos collègues Yang Li et Taku Fujita pour déterminer si le Japon connaît ce que nous avons appelé un « dividende du dépeuplement » de la biodiversité ou autre chose.
Depuis 2003, des centaines de scientifiques citoyens collectent des données sur la biodiversité pour le projet Sites de surveillance 1 000 du gouvernement japonais. Nous avons utilisé 1,5 million d’observations d’espèces enregistrées sur 158 sites.
Ces observations ont été réalisées dans des zones boisées, agricoles et périurbaines (espaces de transition en périphérie des villes). Nous avons comparé ces observations à l’évolution de la population locale, de l’occupation du sol et de la température de surface sur des périodes de cinq à vingt ans.
Notre étude, publiée dans la revue Nature Sustainability, porte sur les oiseaux, les papillons, les lucioles, les grenouilles et 2 922 plantes indigènes et non indigènes. Ces paysages ont connu leur plus grand dépeuplement depuis les années 1990.
En raison de la taille de notre base de données, du choix des sites et du positionnement du Japon comme avant-garde du dépeuplement en Asie du Nord-Est, il s’agit de l’une des plus grandes études de ce type.
Le Japon n’est pas Tchernobyl
La biodiversité a continué de diminuer dans la plupart des zones étudiées, indépendamment de l’augmentation ou de la diminution de la population. Ce n’est que lorsque la population reste stable que la biodiversité est plus stable. Cependant, la population de ces zones vieillit et déclinera bientôt, les rapprochant ainsi des zones déjà touchées par le déclin de la biodiversité.
Contrairement à Tchernobyl, où une crise soudaine a provoqué une évacuation quasi totale, alimentant des récits surprenants de renaissance de la faune, la perte de population au Japon s’est développée progressivement. Ici, une mosaïque de changements d’utilisation des terres émerge au milieu de communautés encore fonctionnelles.
Si la plupart des terres agricoles restent cultivées, certaines tombent en désuétude ou sont abandonnées, d’autres sont vendues pour le développement urbain ou transformées en paysages d’agriculture intensive. Cela empêche la succession végétale naturelle à grande échelle ou le reboisement (plantation de nouveaux arbres) qui enrichiraient la biodiversité.
Dans ces régions, l’homme est un agent de la durabilité des écosystèmes. L’agriculture traditionnelle et les pratiques saisonnières de subsistance, telles que l’inondation, la plantation et la récolte des rizières, la gestion des vergers et des taillis, et l’entretien des propriétés, sont importantes pour le maintien de la biodiversité. Le dépeuplement peut donc être destructeur pour la nature. Certaines espèces prospèrent, mais il s’agit souvent d’espèces non indigènes qui présentent d’autres défis, comme l’assèchement et l’étouffement des rizières autrefois humides par des graminées envahissantes.
Les bâtiments vacants et abandonnés, les infrastructures sous-utilisées et les problèmes socio-juridiques (tels que les lois complexes sur les successions et les taxes foncières, le manque de capacité administrative des autorités locales et les coûts élevés de démolition et d’élimination) aggravent le problème.

Alors que le nombre d’akiya (maisons vides, désaffectées ou abandonnées) atteint près de 15 % du parc immobilier national, la construction de nouveaux logements se poursuit sans relâche. En 2024, plus de 790 000 logements ont été construits, en partie en raison de l’évolution de la répartition de la population et de la composition des ménages au Japon. À cela s’ajoutent les routes, les centres commerciaux, les installations sportives, les parkings et les commerces de proximité omniprésents au Japon. Au total, la faune sauvage dispose de moins d’espace et de moins de niches pour s’y installer, malgré la diminution de la population.
Que peut-on faire ?
Les données montrent une aggravation du dépeuplement au Japon et en Asie du Nord-Est. Les taux de fécondité restent faibles dans la plupart des pays développés. L’immigration n’offre qu’un atterrissage en douceur à court terme, car les pays qui fournissent actuellement des migrants, comme le Vietnam, sont également en voie de dépeuplement.
Nos recherches démontrent que le rétablissement de la biodiversité doit être géré activement, notamment dans les zones en déclin. Malgré cela, les projets de ré-ensauvagement sont peu nombreux au Japon. Pour favoriser leur développement, les autorités locales pourraient être habilitées à convertir des terres désaffectées en réserves communautaires gérées localement.
L’épuisement de la nature constitue un risque systémique pour la stabilité économique mondiale. Les risques écologiques, tels que le déclin des stocks de poissons ou la déforestation, nécessitent une plus grande responsabilisation de la part des gouvernements et des entreprises. Plutôt que de dépenser davantage en infrastructures pour une population en constante diminution, par exemple, les entreprises japonaises pourraient investir dans la croissance des forêts naturelles locales pour obtenir des crédits carbone.
Le dépeuplement s’impose comme une mégatendance mondiale du XXIe siècle. Bien géré, il pourrait contribuer à réduire les problèmes environnementaux les plus urgents de la planète, notamment la consommation de ressources et d’énergie, les émissions et les déchets, ainsi que la préservation de la nature. Mais il doit être géré activement pour que ces opportunités se concrétisent.
Rédacteur Fetty Adler
Collaborateur Jo Ann
Auteurs
Pierre Matanle, Maître de conférences en études japonaises, Université de Sheffield.
Kei Uchida, Professeur associé, Conservation et gestion de la biodiversité, Université de la ville de Tokyo
Masayoshi K. Hiraiwa, Chercheur postdoctoral, Écologie, Faculté d’agriculture, Université Kindai Japon.
Cet article est republié du site The Conversation, sous licence Creative Commons.
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.